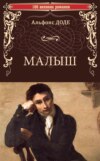Loe raamatut: «Lettres de mon moulin», lehekülg 10
Les sauterelles
Encore un souvenir d’Algérie, et puis nous reviendrons au moulin…
La nuit de mon arrivée dans cette ferme du Sahel, je ne pouvais pas dormir. Le pays nouveau, l’agitation du voyage, les aboiements des chacals, puis une chaleur énervante, oppressante, un étouffement complet, comme si les mailles de la moustiquaire n’avaient pas laissé un souffle d’air…
Quand j’ouvris ma fenêtre, au petit jour, une brume d’été lourde, lentement remuée, frangée aux bords de noir et de rose, flottait dans l’air comme un nuage de poudre sur un champ de bataille. Pas une feuille ne bougeait et, dans ces beaux jardins que j’avais sous les yeux, les vignes espacées sur les pentes, au grand soleil qui fait les vins sucrés, les fruits d’Europe abrités dans un coin d’ombre, les petits orangers, les mandariniers en longues files microscopiques, tout gardait le même aspect morne, cette immobilité des feuilles attendant l’orage, les bananiers eux-mêmes, ces grands roseaux vert tendre, toujours agités par quelque souffle qui emmêle leur fine chevelure si légère, se dressaient silencieux et droits, en panaches réguliers.
Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d’eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante ; et tout en admirant le luxe et l’ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d’aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu’il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s’installer dans ce vallon du Sahel, ils n’avaient trouvé qu’une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. A chaque instant des révoltes d’Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l’inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d’efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante !
Encore maintenant, malgré les mauvais temps finis et la fortune si chèrement gagnée, tous deux, l’homme et la femme, étaient les premiers levés à la ferme. A cette heure matinale je les entendais aller et venir dans les grandes cuisines du rez-de-chaussée, surveillant le café des travailleurs. Bientôt une cloche sonna, et au bout d’un moment les ouvriers défilèrent sur la route. Des vignerons de Bourgogne ; des laboureurs kabyles en guenilles, coiffés d’une chéchia rouge ; des Maltais ; des Lucquois ; tout un peuple disparate, difficile à conduire. A chacun d’eux le fermier, devant la porte, distribuait sa tâche de la journée d’une voix brève, un peu rude. Quand il eut fini, le brave homme leva la tête, scruta le ciel d’un air inquiet ; puis m’apercevant à la fenêtre :
«Mauvais temps pour la culture, me dit-il… voilà le sirocco.»
En effet, à mesure que le soleil se levait, des bouffées d’air, brûlantes, suffocantes, nous arrivaient du sud comme de la porte d’un four ouverte et refermée. On ne savait où se mettre, que devenir. Toute la matinée se passa ainsi. Nous prîmes du café sur les nattes de la galerie, sans avoir le courage de parler ni de bouger. Les chiens allongés, cherchant la fraîcheur des dalles, s’étendaient dans des poses accablées. Le déjeuner nous remit un peu, un déjeuner plantureux et singulier où il y avait des carpes, des truites, du sanglier, du hérisson, le beurre de Staouëli, les vins de Crescia, des goyaves, des bananes, tout un dépaysement de mets qui ressemblaient bien à la nature si complexe dont nous étions entourés… On allait se lever de table. Tout à coup, à la porte-fenêtre, fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin en fournaise, de grands cris retentirent :
«Les criquets ! les criquets !»
Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l’habitation, si calme tout à l’heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l’agitation d’un réveil. De l’ombre des vestibules où ils s’étaient endormis, les serviteurs s’élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D’autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d’une note suraiguë les «you ! you ! you !» des femmes arabes accourues d’un douar voisin. Souvent, parait-il, il suffit d’un grand bruit, d’un frémissement sonore de l’air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre.
Mais où étaient-elles donc ces terribles bêtes ? Dans le ciel vibrant de chaleur, je ne voyais rien qu’un nuage venant à l’horizon, cuivré, compact, comme un nuage de grêle, avec le bruit d’un vent d’orage dans les mille rameaux d’une forêt. C’étaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs ailes sèches étendues, elles volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s’avançait toujours, projetant dans la plaine une ombre immense. Bientôt il arriva au-dessus de nos têtes ; sur les bords on vit pendant une seconde un effrangement, une déchirure. Comme les premiers grains d’une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres ; ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d’insectes tomba drue et bruyante. A perte de vue, les champs étaient couverts de criquets, de criquets énormes, gros comme le doigt.
Alors le massacre commença. Hideux murmure d’écrasement, de paille broyée. Avec les herbes, les pioches, les charrues, on remuait ce sol mouvant ; et plus on en tuait, plus il y en avait. Elles grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevêtrées ; celles du dessus faisant des bonds de détresse, sautant au nez des chevaux attelés pour cet étrange labour. Les chiens de la ferme, ceux du douar, lancés à travers champs, se ruaient sur elles, les broyaient avec fureur. A ce moment, deux compagnies de turcos, clairons en tête, arrivèrent au secours des malheureux colons, et la tuerie changea d’aspect.
Au lieu d’écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues traînées de poudre.
Fatigué de tuer, écœuré par l’odeur infecte, je rentrai. A l’intérieur de la ferme, il y en avait presque autant que dehors. Elles étaient entrées par les ouvertures des portes, des fenêtres, la baie des cheminées. Au bord des boiseries, dans les rideaux déjà tout mangés, elles se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient aux murs blancs avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours cette odeur épouvantable. A dîner, il fallut se passer d’eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, tout était infecté. Le soir, dans ma chambre, où l’on en avait pourtant tué des quantités, j’entendis encore des grouillements sous les meubles, et ce craquement d’élytres semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la grande chaleur. Cette nuit-là non plus je ne pus pas dormir. D’ailleurs, autour de la ferme tout restait éveillé. Des flammes couraient au ras du sol d’un bout à l’autre de la plaine. Les turcos en tuaient toujours.
Le lendemain, quand j’ouvris ma fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties ; mais quelle ruine elles avaient laissée derrière elle ! Plus une fleur, plus un brin d’herbe : tout était noir, rongé, calciné. Les bananiers, les abricotiers, les pêchers, les mandariniers se reconnaissaient seulement à l’allure de leurs branches dépouillées, sans le charme, le flottant de la feuille qui est la vie de l’arbre. On nettoyait les pièces d’eau, les citernes. Partout des laboureurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soigneusement. Et le cœur se serrait de voir les mille racines blanches, pleines de sève, qui apparaissaient dans cet écroulement de terre fertile…
L’élixir du révérend père Gaucher
«Buvez ceci, mon voisin ; vous m’en direz des nouvelles.»
Et, goutte à goutte, avec le soin minutieux d’un lapidaire comptant des perles, le curé de Graveson me versa deux doigts d’une liqueur verte, dorée, chaude, étincelante, exquise… J’en eus l’estomac tout ensoleillé.
«C’est l’élixir du père Gaucher, la joie et la santé de notre Provence, me fit le brave homme d’un air triomphant ; on le fabrique au couvent des prémontrés, à deux lieues de votre moulin… N’est-ce pas que cela vaut bien toutes les chartreuses du monde ?… Et si vous saviez comme elle est amusante, l’histoire de cet élixir ! Ecoutez plutôt…»
Alors, tout naïvement, sans y entendre malice, dans cette salle à manger de presbytère, si candide et si calme avec son chemin de croix en petits tableaux et ses jolis rideaux clairs empesés comme des surplis, l’abbé me commença une historiette légèrement sceptique et irrévérencieuse, à la façon d’un conte d’Erasme ou de d’Assoucy,…
Il y a vingt ans, les prémontrés, ou plutôt les pères blancs, comme les appellent nos Provençaux, étaient tombés dans une grande misère. Si vous aviez vu leur maison de ce temps-là, elle vous aurait fait peine.
Le grand mur, la tour Pacôme s’en allaient en morceaux. Tout autour du cloître rempli d’herbes, les colonnettes se fendaient, les saints de pierre croulaient dans leurs niches. Pas un vitrail debout, pas une porte qui tînt. Dans les préaux, dans les chapelles, le vent du Rhône soufflait comme en Camargue, éteignant les cierges, cassant le plomb des vitrages, chassant l’eau des bénitiers. Mais le plus triste de tout, c’était le clocher du couvent, silencieux comme un pigeonnier vide, et les pères, faute d’argent pour s’acheter une cloche, obligés de sonner matines avec des cliquettes de bois d’amandier !…
Pauvres pères blancs ! Je les vois encore, à la procession de la Fête-Dieu, défilant tristement dans leurs capes rapiécées, pâles, maigres, nourris de citres et de pastèques, et derrière eux monseigneur l’abbé, qui venait la tête basse, tout honteux de montrer au soleil sa crosse dédorée et sa mitre de laine blanche mangée des vers. Les dames de la confrérie en pleuraient de pitié dans les rangs, et les gros porte-bannière ricanaient entre eux tout bas en se montrant les pauvres moines :
«Les étourneaux vont maigres quand ils vont en troupe.»
Le fait est que les infortunés pères blancs en étaient arrivés eux-mêmes à se demander s’ils ne feraient pas mieux de prendre leur vol à travers le monde et de chercher pâture chacun de son côté.
Or, un jour que cette grave question se débattait dans le chapitre on vint annoncer au prieur que le frère Gaucher demandait à être entendu du conseil… Vous saurez pour votre gouverne que ce frère Gaucher était le bouvier du couvent ; c’est-à-dire qu’il passait ses journées à rouler d’arcade en arcade dans le cloître, en poussant devant lui deux vaches étiques qui cherchaient l’herbe aux fentes des pavés. Nourri jusqu’à douze ans par une vieille folle du pays des Baux, qu’on appelait tante Bégon, recueilli depuis chez les moines, le malheureux bouvier n’avait jamais pu apprendre qu’à conduire ses bêtes et à réciter son Pater noster ; encore le disait-il en provençal, car il avait la cervelle dure et l’esprit fin comme une dague de plomb. Fervent chrétien du reste, quoique un peu visionnaire, à l’aise sous le cilice et se donnant la discipline avec une conviction robuste, et des bras !…
Quand on le vit entrer dans la salle du chapitre, simple et balourd, saluant l’assemblée la jambe en arrière, prieur, chanoines, argentier, tout le monde se mit à rire. C’était toujours l’effet que produisait, quand elle arrivait quelque part, cette bonne face grisonnante avec sa barbe de chèvre et ses yeux un peu fous ; aussi le frère Gaucher ne s’en émut pas.
«Mes révérends, fit-il d’un ton bonasse en tortillant son chapelet de noyaux d’olives, on a bien raison de dire que ce sont les tonneaux vides qui chantent le mieux. Figurez-vous qu’à force de creuser ma pauvre tête déjà si creuse, je crois que j’ai trouvé le moyen de nous tirer tous de peine.
«Voici comment. Vous savez bien tante Bégon, cette brave femme qui me gardait quand j’étais petit. – Dieu ait son âme, la vieille coquine ! elle chantait de bien vilaines chansons après boire. – Je vous dirai donc, mes révérends pères, que tante Bégon, de son vivant, se connaissait aux herbes de montagne autant et mieux qu’un vieux merle de Corse. Voire, elle avait composé, sur la fin de ses jours, un élixir incomparable en mélangeant cinq ou six espèces de simples que nous allions cueillir ensemble dans les Alpilles. Il y a belles années de cela ; mais je pense qu’avec l’aide de saint Augustin et la permission de notre père abbé, je pourrais – en cherchant bien – retrouver la composition de ce mystérieux élixir. Nous n’aurions plus alors qu’à le mettre en bouteilles, et à le vendre un peu cher, ce qui permettrait à la communauté de s’enrichir doucettement, comme ont fait nos frères de la Trappe et de la Grande…»
Il n’eut pas le temps de finir. Le prieur s’était levé pour lui sauter au cou. Les chanoines lui prenaient les mains. L’argentier, encore plus ému que tous les autres, lui baisait avec respect le bord tout effrangé de sa cuculle… Puis chacun revint à sa chaire pour délibérer ; et, séance tenante, le chapitre décida qu’on confierait les vaches au frère Thrasybule, pour que le frère Gaucher pût se donner tout entier à la confection de son élixir.
Comment le bon frère parvint-il à retrouver la recette de tante Bégon ? au prix de quels efforts ? au prix de quelles veilles ? L’histoire ne le dit pas. Seulement, ce qui est sûr, c’est qu’au bout de six mois, l’élixir des pères blancs était déjà très populaire. Dans tout le Comtat, dans tout le pays d’Arles, pas un mas, pas une grange qui n’eût au fond de sa dépense, entre les bouteilles de vin cuit et les jarres d’olives à la picholine, un petit flacon de terre brune cacheté aux armes de Provence, avec un moine en extase sur une étiquette d’argent. Grâce à la vogue de son élixir, la maison des prémontrés s’enrichit très rapidement. On releva la tour Pacôme. Le prieur eut une mitre neuve, l’église de jolis vitraux ouvragés ; et, dans la fine dentelle du clocher, toute une compagnie de cloches et de clochettes vint s’abattre, un beau matin de Pâques, tintant et carillonnant à la grande volée.
Quant au frère Gaucher, ce pauvre frère lai dont les rusticités égayaient tant le chapitre, il n’en fut plus question dans le couvent. On ne connut plus désormais que le révérend père Gaucher, homme de tête et de grand savoir, qui vivait complètement isolé des occupations si menues et si multiples du cloître, et s’enfermait tout le jour dans sa distillerie, pendant que trente moines battaient la montagne pour lui chercher des herbes odorantes… Cette distillerie, où personne, pas même le prieur, n’avait le droit de pénétrer, était une ancienne chapelle abandonnée, tout au bout du jardin des chanoines. La simplicité des bons pères en avait fait quelque chose de mystérieux et de formidable ; et si, par aventure, un moinillon hardi et curieux, s’accrochant aux vignes grimpantes, arrivait jusqu’à la rosace du portail, il en dégringolait bien vite, effaré d’avoir vu le père Gaucher, avec sa barbe de nécromant, penché sur ses fourneaux, le pèse-liqueur à la main ; puis, tout autour, des cornues de grès rose, des alambics gigantesques, des serpentins de cristal, tout un encombrement bizarre qui flamboyait ensorcelé dans la lueur rouge des vitraux…
Au jour tombant, quand sonnait le dernier Angélus, la porte de ce lieu de mystère s’ouvrait discrètement, et le révérend se rendait à l’église pour l’office du soir. Il fallait voir quel accueil quand il traversait le monastère ! Les frères faisaient la haie sur son passage. On disait :
«Chut !… il a le secret !…»
L’argentier le suivait et lui parlait la tête basse… Au milieu de ces adulations, le père s’en allait en s’épongeant le front, son tricorne aux larges bords posé en arrière comme une auréole, regardant autour de lui d’un air de complaisance les grandes cours plantées d’orangers, les toits bleus où tournaient des girouettes neuves, et, dans le cloître éclatant de blancheur – entre les colonnettes élégantes et fleuries –, les chanoines habillés de frais qui défilaient deux par deux avec des mines reposées.
«C’est à moi qu’ils doivent tout cela !» se disait le révérend en lui-même ; et chaque fois cette pensée lui faisait monter des bouffées d’orgueil.
Le pauvre homme en fut bien puni. Vous allez voir…
Figurez-vous qu’un soir, pendant l’office, il arriva à l’église dans une agitation extraordinaire : rouge, essoufflé, le capuchon de travers, et si troublé qu’en prenant de l’eau bénite il y trempa ses manches jusqu’au coude. On crut d’abord que c’était l’émotion d’arriver en retard ; mais quand on le vit faire de grandes révérences à l’orgue et aux tribunes au lieu de saluer le maître-autel, traverser l’église en coup de vent, errer dans le chœur pendant cinq minutes pour chercher sa stalle, puis, une fois assis, s’incliner de droite et de gauche en souriant d’un air béat, un murmure d’étonnement courut dans les trois nefs. On chuchotait de bréviaire à bréviaire :
«Qu’a donc notre père Gaucher ?… Qu’a donc notre père Gaucher ?»
Par deux fois le prieur, impatienté, fit tomber sa crosse sur les dalles pour commander le silence… Là-bas, au fond du chœur, les psaumes allaient toujours ; mais les répons manquaient d’entrain…
Tout à coup, au beau milieu de l’Ave verum, voilà mon père Gaucher qui se renverse dans sa stalle et entonne d’une voix éclatante :
Dans Paris, il y a un père blanc,
Patatin, patatan, tarabin, taraban…
Consternation générale. Tout le monde se lève. On crie :
«Emportez-le… il est possédé !»
Les chanoines se signent. La crosse de monseigneur se démène… Mais le père Gaucher ne voit rien, n’écoute rien ; et deux moines vigoureux sont obligés de l’entraîner par la petite porte du chœur, se débattant comme un exorcisé et continuant de plus belle ses palatin et ses taraban.
Le lendemain, au petit jour, le malheureux était à genoux dans l’oratoire du prieur, et faisait sa coulpe avec un ruisseau de larmes :
«C’est l’élixir, monseigneur, c’est l’élixir qui m’a surpris», disait-il en se frappant la poitrine.
Et de le voir si marri, si repentant, le bon prieur en était tout ému lui-même.
«Allons, allons, père Gaucher, calmez-vous, tout cela séchera comme la rosée au soleil… Après tout, le scandale n’a pas été aussi grand que vous pensez. Il y a bien eu la chanson qui était un peu… hum ! hum !… Enfin il faut espérer que les novices ne l’auront pas entendue… A présent, voyons, dites-moi bien comment la chose vous est arrivée… C’est en essayant l’élixir, n’est-ce pas ? Vous aurez eu la main trop lourde… Oui, oui, je comprends… C’est comme le frère Schwartz, l’inventeur de la poudre : vous avez été victime de votre invention… Et dites-moi, mon brave ami, est-il bien nécessaire que vous l’essayiez sur vous-même ce terrible élixir ?
– Malheureusement, oui, monseigneur… l’éprouvette me donne bien la force et le degré de l’alcool ; mais pour le fini, le velouté, je ne me fie guère qu’à ma langue…
– Ah ? très bien… Mais écoutez encore un peu que je vous dise… Quand vous goûtez ainsi l’élixir par nécessité, est-ce que cela vous semble bon ? Y prenez-vous du plaisir ?…
– Hélas ! oui, monseigneur, fit le malheureux père en devenant tout rouge… Voilà deux soirs que je lui trouve un bouquet, un arôme !… C’est pour sûr le démon qui m’a joué ce vilain tour… Aussi je suis bien décidé désormais à ne plus me servir que de l’éprouvette. Tant pis si la liqueur n’est pas assez fine, si elle ne fait pas assez la perle…
– Gardez-vous-en bien, interrompit le prieur avec vivacité. Il ne faut pas s’exposer à mécontenter la clientèle… Tout ce que vous avez à faire maintenant que vous voilà prévenu, c’est de vous tenir sur vos gardes… Voyons, qu’est-ce qu’il vous faut pour vous rendre compte ?… Quinze ou vingt gouttes, n’est-ce pas ?… mettons vingt gouttes… Le diable sera bien fin s’il vous attrape avec vingt gouttes. D’ailleurs, pour prévenir tout accident, je vous dispense dorénavant de venir à l’église. Vous direz l’office du soir dans la distillerie… Et maintenant, allez en paix, mon révérend, et surtout… comptez bien vos gouttes.»
Hélas, le pauvre révérend eut beau compter ses gouttes… le démon le tenait, et ne le lâcha plus.
C’est la distillerie qui entendit de singuliers offices !
Le jour, encore, tout allait bien. Le père était assez calme : il préparait ses réchauds, ses alambics, triait soigneusement ses herbes, toutes herbes de Provence, fines, grises, dentelées, brûlées de parfums et de soleil… Mais, le soir, quand les simples étaient infusés et que l’élixir tiédissait dans de grandes bassines de cuivre rouge, le martyre du pauvre homme commençait.
«… Dix-sept… dix-huit… dix-neuf… vingt !…»
Les gouttes tombaient du chalumeau dans le gobelet de vermeil. Ces vingt-là, le père les avalait d’un trait, presque sans plaisir. Il n’y avait que la vingt et unième qui lui faisait envie. Oh ! cette vingt et unième goutte !… Alors, pour échapper à la tentation, il allait s’agenouiller tout au bout du laboratoire et s’abîmait dans ses patenôtres. Mais de la liqueur encore chaude il montait une petite fumée toute chargée d’aromates, qui venait rôder autour de lui et, bon gré, mal gré, le ramenait vers les bassines… La liqueur était d’un beau vert doré… Penché dessus, les narines ouvertes, le père la remuait tout doucement avec son chalumeau, et dans les petites paillettes étincelantes que roulait le flot d’émeraude, il lui semblait voir les yeux de tante Bégon qui riaient et pétillaient en le regardant…
«Allons ! encore une goutte !»
Et de goutte en goutte, l’infortuné finissait par avoir son gobelet plein jusqu’au bord. Alors, à bout de forces, il se laissait tomber dans un grand fauteuil, et, le corps abandonné, la paupière à demi close, il dégustait son péché par petits coups, en se disant tout bas avec un remords délicieux :
«Ah ! je me damne… je me damne…»
Le plus terrible, c’est qu’au fond de cet élixir diabolique, il retrouvait, par je ne sais quel sortilège, toutes les vilaines chansons de tante Bégon : Ce sont trois petites commères, qui parlent de faire un banquet… ou : Bergerette de maître André s’en va-t-au bois seulette… et toujours la fameuse des pères blancs : Patatin patatan.
Pensez quelle confusion le lendemain, quand ses voisins de cellule lui faisaient d’un air malin :
«Eh ! eh ! père Gaucher, vous aviez des cigales en tête, hier soir en vous couchant.»
Alors c’étaient des larmes, des désespoirs, et le jeûne, et le cilice, et la discipline. Mais rien ne pouvait contre le démon de l’élixir ; et tous les soirs, à la même heure, la possession recommençait.
Pendant ce temps, les commandes pleuvaient à l’abbaye que c’était bénédiction. Il en venait de Nîmes, d’Aix, d’Avignon, de Marseille… De jour en jour le couvent prenait un petit air de manufacture. Il y avait des frères emballeurs, des frères étiqueteurs, d’autres pour les écritures, d’autres pour le camionnage ; le service de Dieu y perdait bien par-ci, par-là quelques coups de cloches ; mais les pauvres gens du pays n’y perdaient rien, je vous en réponds…
Et donc, un beau dimanche matin, pendant que l’argentier lisait en plein chapitre son inventaire de fin d’année et que les bons chanoines l’écoutaient les yeux brillants et le sourire aux lèvres, voilà le père Gaucher qui se précipite au milieu de la conférence en criant :
«C’est fini… Je n’en fais plus… Rendez-moi mes vaches.
– Qu’est-ce qu’il y a donc, père Gaucher ? demanda le prieur, qui se doutait bien un peu de ce qu’il y avait.
– Ce qu’il y a, monseigneur ? Il y a que je suis en train de me préparer une belle éternité de flammes et de coup de fourche… Il y a que je bois, que je bois comme un misérable…
– Mais je vous avais dit de compter vos gouttes.
– Ah ! bien oui, compter mes gouttes ! c’est par gobelets qu’il faudrait compter maintenant… Oui, mes révérends, j’en suis là. Trois fioles par soirée… Vous comprenez bien que cela ne peut pas durer… Aussi, faites faire l’élixir par qui vous voudrez… Que le feu de Dieu me brûle si je m’en mêle encore !»
C’est le chapitre qui ne riait plus.
«Mais, malheureux, vous nous ruinez ! criait l’argentier en agitant son grand livre.
– Préférez-vous que je me damne ?»
Pour lors, le prieur se leva.
«Mes révérends, dit-il en étendant sa belle main blanche où luisait l’anneau pastoral, il y a un moyen de tout arranger… C’est le soir, n’est-ce pas, mon cher fils, que le démon vous tente ?…
– Oui, monsieur le prieur, régulièrement tous les soirs… Aussi, maintenant, quand je vois arriver la nuit, j’en ai, sauf votre respect, les sueurs qui me prennent, comme l’âne du Capitou, quand il voyait venir le bât.
– Eh bien, rassurez-vous… Dorénavant, tous les soirs à l’office, nous réciterons à votre intention l’oraison de saint Augustin à laquelle l’indulgence plénière est attachée… Avec cela, quoi qu’il arrive, vous êtes couvert… C’est l’absolution pendant le péché.
– Oh ! bien, alors, merci, monsieur le prieur !»
Et, sans en demander davantage, le père Gaucher retourna à ses alambics, aussi léger qu’une alouette.
Effectivement, à partir de ce moment-là, tous les soirs à la fin des complies, l’officiant ne manquait jamais de dire :
«Prions pour notre pauvre père Gaucher, qui sacrifie son âme aux intérêts de la communauté… Oremus, Domine…»
Et pendant que sur toutes ces capuches blanches, prosternées dans l’ombre des nefs, l’oraison courait en frémissant comme une petite bise sur la neige, là-bas, tout au bout du couvent, derrière le vitrage enflammé de la distillerie, on entendait le père Gaucher qui chantait à tue-tête :
Dans Paris il y a un père blanc,
Patatin, patatan, taraban, tarabin ;
Dans Paris il y a un père blanc,
Qui fait danser des moinettes,
Trin, trin, trin, dans un jardin ;
Qui fait danser des…
… Ici le bon curé s’arrêta plein d’épouvante :
«Miséricorde ! si mes paroissiens m’entendaient !»