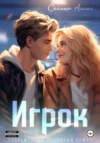Loe raamatut: «Henri IV en Gascogne (1553-1589)»
INTRODUCTION
Il est des hommes si universellement aimés, qu'on voudrait tout connaître d'eux, au risque d'arriver à la désillusion. Cette remarque, faite depuis longtemps, n'a jamais été plus justifiée que par la curiosité, mêlée d'enthousiasme et de vénération, qui s'est constamment attachée aux moindres détails comme aux actes solennels de la vie de Henri IV. Ses batailles et ses négociations, ses lettres et ses propos, ce qu'il a fait et ce qu'il a projeté, tout son personnage et toute sa personne, enfin, seront toujours, comme ils l'ont toujours été, un des nobles régals de l'esprit humain.
Ce n'est pas nous qui réagirons contre ce culte passionné. Des mille volumes d'inégal renom que trois siècles ont consacrés à la gloire de Henri IV, il en est peu où nous n'ayons cherché une raison de multiplier par elle-même, en quelque sorte, notre admiration pour le roi qui reçut tous les dons en partage et les mit au service de son pays, pour l'homme qui eut la grandeur héroïque et l'invincible charme. Mais, au milieu de cette bibliothèque sans cesse accrue par la piété des générations, nous avons vainement cherché le livre dont voici l'ébauche.
Henri de Bourbon, roi de France, se révèle à tous dans plusieurs écrits de notre temps, composés d'après ceux du XVIe et du XVIIe siècle, rectifiés et complétés par des correspondances heureusement exhumées, surtout par le recueil des Lettres royales. De 1589 à 1610, «Henri IV» revit tout entier dans les ouvrages auxquels nous faisons allusion, et il est probable qu'une nouvelle édition de l'Histoire de Poirson, qui bénéficierait des travaux parus depuis la première, serait, pour cette vaste période, le livre définitif.
Mais, en attendant un nouveau Poirson, nous sommes condamnés à poursuivre le «roi de Navarre» parmi d'épais in-folio non lisibles pour tous, d'énormes compilations où se perdent parfois ses traces, des Mémoires qui souvent racontent et jugent en sens divers, des lettres, caractéristiques et précieuses, mais dont le commentaire est un travail et la seule lecture, une étude1.
Ce fut de ces impressions personnelles que naquirent en nous, d'abord le regret de ne pas connaître un livre qui les épargnât au public, et ensuite la pensée d'essayer de l'écrire. Mais, à travers les lignes encore confuses du plan, nous eûmes tout à coup la claire vision d'un fait considérable, peut-être soupçonné auparavant, non indiqué toutefois, et que certainement pas un des historiens ni des biographes de Henri IV n'a mis en lumière. Le voici, tel qu'il ressort, à nos yeux, de l'histoire des années antérieures à l'avènement de ce prince au trône de France.
Quelque digne de l'admiration universelle que soit l'œuvre de Henri IV depuis 1589 jusqu'à sa mort, il n'en est presque rien de grand, presque rien d'heureux pour la France, que le roi de Navarre n'eût déjà manifestement voulu, projeté et entrepris. Avant de succéder à Henri III, il avait donné la mesure de son génie et laissé lire jusqu'au fond de son cœur. Capitaine, il portait en lui les secrets de la victoire, depuis Cahors et Coutras; politique, il arrivait au trône avec la connaissance approfondie des hommes, des idées et des besoins de son temps; pasteur de peuples, il avait fait entendre, le premier, au milieu des guerres civiles, ces mots sacrés de paix, de tolérance, de pitié, oubliés dans la fièvre des compétitions et la barbarie des luttes. Henri de Bourbon était «Henri IV» avant que le flot des événements l'eût transporté de «Gascogne» en «France», comme on disait au XVIe siècle. Quand il y fut, l'homme et l'œuvre s'accomplirent.
Cette vérité, qui explique l'apparente incorrection de notre titre, ne sera contestée, nous l'espérons, par aucun des lecteurs de Henri IV en Gascogne.
LIVRE PREMIER
(1553-1575)
CHAPITRE PREMIER
Le royaume de Navarre depuis les Carlovingiens jusqu'aux Valois. – Son démembrement par Ferdinand le Catholique. – Les Etats de la Maison d'Albret. – Les prétendants de Jeanne d'Albret. – Ses fiançailles, à Châtellerault, avec le duc de Clèves. – Marguerite, reine de Navarre, et la Réforme. – Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, épouse Jeanne d'Albret. – Leurs deux premiers enfants. – Mort de la reine Marguerite. – Henri d'Albret et sa fille. – Naissance de Henri de Bourbon, prince de Navarre. – Ses huit nourrices. – Le baptême catholique de Henri. – Le calvinisme en 1553.
Quand on veut faire revivre dans un récit, même épisodique, la France du XVIe siècle, il faut avoir présente à l'esprit l'histoire de ce petit royaume de Navarre qui exerça une si grande influence sur nos destinées nationales. De même la figure de Henri IV n'apparaîtrait pas en pleine lumière, si l'on n'avait d'abord entrevu, tout au moins sous forme d'esquisse, la figure de Jeanne d'Albret. Dans les pages qui vont suivre, on verra longtemps la mère auprès du fils, et de cette vie à deux se dégageront quelques-unes des clartés nécessaires auxquelles nous venons de faire allusion. Les autres, celles qui tiennent à l'existence et à la situation du royaume de Navarre, doivent être mises avant tout à la portée du lecteur.
La Navarre, après d'ardentes luttes contre Pepin, Charlemagne et ses successeurs, s'était définitivement affranchie de la domination des Carlovingiens en l'an 860, où elle forma un royaume indépendant, avec Pampelune pour capitale. En 1224, Thibaut IV, comte de Champagne, neveu de Sanche IV, roi de Navarre, lui succéda par voie d'adoption, et ce fut en 1488, par le mariage de Catherine de Foix, sœur et héritière de François Phœbus, avec Jean d'Albret, que les ancêtres maternels de Henri IV entrèrent en possession de ce royaume, qui ne tarda pas à être démembré. Dix-sept ans après, en 1512, Ferdinand le Catholique, roi de Castille et d'Aragon, voulut faire de Jean d'Albret son allié dans une guerre contre Louis XII, et exigea le passage à main armée sur ses terres. Allié naturel du roi de France, Jean refusa, et Ferdinand, après avoir obtenu du pape Jules II une bulle d'excommunication contre le roi de Navarre, envahit les Etats de ce prince, incapable de lui opposer une sérieuse résistance. Ainsi fut perdue pour la Maison d'Albret toute la Navarre transpyrénéenne, qu'on appelait la Haute-Navarre. Constamment revendiquée par les successeurs de Jean, elle ne fut jamais restituée, et les lettres de Henri de Bourbon, avant son avènement au trône de France, font souvent allusion à cet acte de violence et d'iniquité.
La Basse-Navarre, sur laquelle Henri d'Albret régnait en 1553, n'était donc qu'une province de l'ancien royaume. Son étendue et celle du Béarn, autre pays souverain, égalaient à peine la superficie d'un de nos grands départements actuels. Outre ces Etats, la Maison d'Albret possédait, à titre de fiefs, ou gouvernait pour la couronne de France, les comtés de Foix, de Bigorre et d'Armagnac, la vicomté d'Albret, dont Nérac était la capitale, la Guienne, qui englobait le Languedoc; et enfin ses droits s'étendaient sur plusieurs autres seigneuries de moindre importance.
A vrai dire, le royaume de Navarre n'était plus qu'un nom, mais la Maison d'Albret était une puissance réelle, et lorsque, en 1548, elle s'unit à la Maison de Bourbon par le mariage de Jeanne avec Antoine, duc de Vendôme, prince du sang, les esprits pénétrants auraient pu noter cet agrandissement en quelque sorte dynastique. Il n'en fut pas ainsi: les politiques du temps semblent avoir vu dans cette alliance, du côté de la Maison d'Albret, plutôt un pis-aller qu'un progrès. C'est que Jeanne d'Albret, avant de devenir duchesse de Vendôme, avait paru destinée à s'asseoir sur un des premiers trônes du monde: son mariage avec Philippe, fils et héritier présomptif de Charles-Quint, fut considéré quelque temps comme probable, et malgré l'antipathie de François Ier pour le vainqueur de Pavie, il se fût peut-être accompli, si l'on avait pu s'entendre pour la restitution de la Haute-Navarre.
En 1540, le roi de France, saisissant l'occasion de créer un grave embarras à la Maison d'Autriche, résolut de marier Jeanne, sa nièce, avec le duc de Clèves et de Julliers, qui avait à se plaindre de l'Empereur. Henri d'Albret et Marguerite, par déférence, donnèrent leur consentement, quoique les Etats de Béarn se fussent élevés avec énergie contre ce projet, que la princesse elle-même, à peine âgée de douze ans, avait accueilli avec une répugnance manifeste. Le mariage religieux fut célébré, le 15 juillet, à Châtellerault. François Ier voulut qu'on déployât dans cette solennité toutes les magnificences royales; Brantôme raconte que Jeanne était si chargée d'atours et de pierreries, qu'elle dut être «portée à l'église» dans les bras du connétable de Montmorency. Mais ce n'étaient là que des fiançailles. Trois ans ne s'étaient pas écoulés, que le duc de Clèves, trahissant les intérêts de François Ier, par une soumission honteuse à l'Empereur, s'attira l'inimitié du roi. Paul III accorda une bulle d'annulation. Le mariage définitif de Jeanne d'Albret eut lieu sous le règne de Henri II. Le roi et la reine de Navarre hésitaient, depuis longtemps, entre plusieurs projets d'union, et leur plein agrément n'était pas acquis à Antoine de Bourbon, que présentait le successeur de François Ier; mais la préférence de Jeanne s'étant manifestée, le duc de Vendôme épousa, le 20 octobre 1548, l'héritière du royaume de Navarre.
De l'aveu de tous les historiens, Jeanne, surnommée la «mignonne des rois», était une princesse accomplie. Elle tenait de son père et aussi de François Ier, son oncle, un cœur chevaleresque, un caractère noblement altier; sa mère, la savante et poétique Marguerite, l'avait dotée d'un esprit cultivé, peut-être un peu trop libre, en même temps que d'un reflet de cette beauté et de cette grâce qui charmèrent un demi-siècle et dont trois siècles écoulés n'ont pu ternir l'éclat. La reine de Navarre avait transporté avec elle, à Pau et à Nérac, quelques-unes des splendeurs de la Renaissance et des élégances raffinées de la cour des Valois. On a prétendu qu'elle y avait fait éclore la Réforme, dont elle aurait même embrassé les doctrines. La vérité est que, d'un esprit curieux et hardi, elle voulut connaître la rhétorique du calvinisme, lui donna accès auprès d'elle, dans la personne de ses docteurs et de ses poètes, l'étudia, la discuta, la loua sur plus d'un point, et, sans s'en apercevoir, favorisa dangereusement l'œuvre d'une secte. Mais, sectaire ou même néophyte, elle ne le fut point, tous les témoignages le proclament: Marguerite vécut et mourut en catholique. Il n'en est pas moins certain que l'espèce de «libertinage» intellectuel dont Jeanne eut le spectacle à la cour de sa mère devait avoir sur son avenir une influence décisive, pour peu que les circonstances vinssent réveiller de vifs souvenirs et seconder de vagues penchants. Mais, à l'heure où se négociait son mariage, rien ne faisait pressentir en elle la princesse politique et la zélatrice de la Réforme qui, plus tard, méritèrent tantôt les admirations, tantôt les sévérités de l'histoire2.
Antoine de Bourbon, qu'elle allait épouser, était le chef de la Maison de Vendôme, issue de saint Louis. La terre de Vendôme était passée dans la famille de Bourbon en 1364, par le mariage de Catherine de Vendôme avec Jean de Bourbon, comte de la Marche. Ce domaine avait été érigé en duché par François Ier, l'année de son avènement, et Henri II tenait en réserve, pour l'apanage de son cousin, de nouveaux accroissements, tels que le duché-pairie d'Albret, formé de l'ancienne vicomté de ce nom et d'une importante fraction de la Gascogne. Né en 1518, Antoine de Bourbon avait la réputation d'un prince vaillant, «car de cette race de Bourbon», dit Brantôme, «il n'y en a point d'autres.» De grand air et de belle humeur, il eût joué un rôle prépondérant dans les luttes de cette époque, si la versatilité de son caractère et ses galanteries sans frein ne l'eussent jeté en proie aux intrigues de cour.
Le mariage d'Antoine et de Jeanne fut célébré à Moulins. Le roi et la reine de France, le roi et la reine de Navarre y assistèrent, avec la plupart des princes et des grands seigneurs, empressement qui s'explique aisément quand on songe que, la loi salique n'existant pas en Navarre, Jeanne d'Albret apportait en dot au duc de Vendôme, déjà prince du sang de France, non seulement la couronne de Navarre et la principauté de Béarn, mais encore de riches domaines. Par cette union, les Maisons de Bourbon et d'Albret semblaient prendre possession d'un avenir que plus d'une famille princière devait envier ou redouter.
A peine mariée, la duchesse de Vendôme dut se familiariser avec l'existence guerrière et nomade qui était celle d'Antoine de Bourbon. Ses deux premiers enfants vinrent au monde au milieu du bruit des combats. Le duc de Beaumont, né en 1551, mourut l'année suivante, à La Flèche, étouffé, pour ainsi dire, par sa gouvernante, la baillive d'Orléans, qui, dans son horreur maniaque du froid, mesurait parcimonieusement l'air aux poumons de l'enfant. Le second, nommé en naissant comte de Marle, donnait les plus belles espérances, et faisait à la fois la consolation et l'orgueil de Henri d'Albret, lorsqu'il périt à Mont-de-Marsan, de la façon la plus inopinée: sa nourrice le laissa choir par une fenêtre.
Ce fut un deuil inexprimable pour la cour de Navarre, surtout pour le roi, toujours profondément attristé de son veuvage. Marguerite était morte en 1549. Depuis la perte de son frère, ce magnifique François Ier qu'elle avait aimé jusqu'à l'idolâtrie, la reine de Navarre ne faisait plus que languir. Une pleurésie précipita sa fin. Elle séjournait au château d'Odos, près de Tarbes. Pendant une nuit de décembre, l'apparition d'une comète ayant excité sa curiosité, elle commit l'imprudence d'observer ce phénomène. Huit jours après, elle expirait, bénie par l'Eglise et dans des sentiments qui, malgré ses hardiesses d'esprit, avaient été ceux de toute sa vie. Elle fut inhumée dans la cathédrale de Lescar.
Heureusement pour la vieillesse de Henri d'Albret, l'heure des grandes consolations était proche. Au milieu de son deuil, la nouvelle lui parvint d'une troisième grossesse de la duchesse de Vendôme, en ce moment auprès d'Antoine de Bourbon, dans son gouvernement de Picardie. Le roi de Navarre exigea que sa fille revînt en Béarn; on raconte même qu'une députation fut envoyée de Pau à la duchesse, pour hâter son retour. Jeanne, malgré les premières rigueurs de l'hiver, se mit en devoir de traverser la France, entreprise presque téméraire, mais qui n'était pas faite pour effrayer cette princesse: «amazone hardie et courageuse», dit le vieux Favyn, «elle suivait son mari en guerre et en paix, à la cour et au camp.» Partie de Compiègne vers la fin de novembre, elle arriva, le 4 décembre, à Pau, après s'être reposée quelques heures à Mont-de-Marsan, où Henri d'Albret était venu à sa rencontre.
Des bruits inquiétants avaient couru sur les vues d'avenir du roi de Navarre. On disait que, craignant de ne pas se voir revivre dans un petit-fils, il songeait à se remarier, et que l'Espagne, de bonne foi ou par feinte, lui avait offert Catherine de Castille, sœur de Charles-Quint, avec une promesse de restitution de la Haute-Navarre. D'un autre côté, il passait pour être gouverné par une dame de sa cour, à qui son testament assurait de grands avantages. La duchesse de Vendôme, instruite de ces rumeurs, n'avait pu s'empêcher d'en montrer quelque émotion. Le roi s'en expliqua ouvertement avec elle. Dès qu'elle fut installée au château, où la sollicitude paternelle l'entoura de soins presque tyranniques, Henri d'Albret mit sous les yeux de sa fille «une grosse boîte d'or fermée à clef, et par-dessus, pour pendre icelle, une chaîne d'or qui eût pu faire vingt-cinq ou trente tours à l'entour du col; ouvrit cette boîte, lui montra son testament seulement par-dessus, et l'ayant refermée», il lui dit que, testament et bijoux, tout serait à elle, si, afin de ne pas mettre au monde un enfant pleureur ou rechigné, elle avait le courage de chanter un air béarnais, au moment de la naissance3.
Cette naissance eut lieu, dix jours après l'arrivée de Jeanne, le 14 décembre 1553, vers une heure du matin. Averti aussitôt, Henri d'Albret entra dans l'appartement de sa fille. En l'apercevant, elle eut la force et la présence d'esprit de commencer un motet religieux et populaire:
Nousté Dame deü cap deü poun,
Adjudat-me a d'aqueste hore!
Henri, unissant sa voix à celle de la duchesse, n'avait pas achevé la première strophe, que son petit-fils entrait dans la vie: le nouveau-né devait être Henri IV. Le roi de Navarre était loin de pressentir pour sa race les destinées qui attendaient cet enfant; mais il avait pourtant ses rêves d'ambition dans la vie et outre-tombe: son premier vœu était exaucé, il pouvait bien augurer de l'accomplissement des autres. Transporté de joie, l'heureux aïeul tire de son sein la précieuse boîte qui contenait le testament royal, et la déposant entre les mains de la duchesse: « – Voilà qui est à vous, ma fille, dit-il; mais ceci est à moi!» Puis, faisant envelopper son petit-fils dans les pans de sa robe, il emporta, tout triomphant, cette chère et fragile proie jusque dans sa chambre. Là, les premiers soins furent donnés à l'enfant. D'autres traits de mœurs naïfs et touchants signalèrent cette naissance. Les historiens du temps racontent que Henri d'Albret, pour donner une sorte de baptême viril à son petit-fils, lui frotta les lèvres d'une gousse d'ail et lui fit sucer, dans une coupe d'or, quelques gouttes du célèbre vin de Jurançon, récolté sur les collines situées de l'autre côté du Gave, en face du château de Pau: scène pittoresque passée à l'état de tradition, et dont Louis XVIII se souvint, lors de la naissance du duc de Bordeaux. « – Tu seras un vrai Béarnais!» dit le roi de Navarre. Et, se rappelant le sarcasme espagnol qui avait accueilli la venue au monde de Jeanne, son unique héritière: «La vache de Béarn (Marguerite) a enfanté une brebis!» il se plaisait à dire à tout venant: « – Voyez! ma brebis a enfanté un lion!» Le prince dépossédé, le chef humilié de la Maison d'Albret, avait, auprès de ce berceau, la vision d'une revanche royale. La réalité dépassa le rêve: Henri IV fit plus que venger ses ancêtres maternels, il les glorifia par ses actes, en même temps que par son œuvre il replaçait la France, la grande patrie, à la tête des nations.
Les débuts dans la vie du prince de Navarre furent difficiles. L'histoire a fait le compte de ses nourrices: il en eut huit; sept échouèrent dans leur tâche, pour diverses causes; la huitième enfin réussit. C'était une humble paysanne, Jeanne Lafourcade, femme de Lassansa, laboureur qui demeurait à Bilhères, village encore existant de nos jours et, à cette époque, limitrophe de la commune de Pau. Au commencement de notre siècle, la maison de Lassansa avait conservé à peu près sa physionomie d'autrefois: une habitation toute rustique, avec un jardin d'un demi-arpent, clos d'un mur à hauteur d'appui; une porte ouvrant sur la cour, avec cette inscription au fronton: «Saoubegarde deü Rey, – Sauvegarde du Roi». Le parc du château s'étendait jusqu'au seuil de la maisonnette, si bien que Jeanne pouvait aller voir son fils sans sortir du domaine royal.
Le baptême du prince de Navarre ou du prince de Béarn, comme disaient de préférence les Béarnais, fut célébré le 6 mars 15544, dans la chapelle du palais, avec toute la solennité et toute la magnificence dont pouvait disposer la cour élégante de Henri d'Albret. Le roi présenta lui-même son petit-fils sur une écaille de tortue de mer, qui est restée une des reliques du château, et «Henri de Bourbon, comte de Viane, duc de Beaumont», fut baptisé dans des fonts de vermeil, par le cardinal d'Armagnac. Henri II de France et Henri II de Navarre étaient parrains, le premier représenté par le cardinal de Vendôme, frère d'Antoine de Bourbon. Le prince eut pour marraines la reine de France et Isabeau d'Albret, sa tante, veuve du comte de Rohan. Il peut sembler oiseux de commenter ce fait, que le baptême du fils de Jeanne d'Albret fut essentiellement catholique, et que tout l'était autour du berceau de Henri de Bourbon. Nous ne jugeons pourtant pas inutile de marquer d'une réflexion cette entrée dans la vie religieuse, en un temps où les contre-vérités historiques et les préjugés de secte sont parvenus à dénaturer tant d'événements, à travestir tant de figures, à rejeter dans l'ombre ou dans la pénombre ce que le bon sens doit juger clair comme la lumière du soleil. Beaucoup d'historiens passent légèrement sur le baptême du prince de Navarre, n'insistent pas sur la nouvelle foi que lui imposa plus tard Jeanne d'Albret, et parlent avec émotion, sinon avec amertume, de l'abjuration ou même de l'apostasie du roi de France! Henri était né catholique comme son père, comme sa mère, comme tous ses ancêtres; on abjura pour lui dans son enfance, et il abjura lui-même sous les poignards de la Saint-Barthélemy; chef de parti, dans la suite, il ne laissa jamais désespérer de son retour à la religion traditionnelle; homme et roi, enfin, il y tendit de toutes ses forces, avec une sincérité et une grandeur d'âme qui, plus que son épée peut-être, vainquirent et pacifièrent la France.
L'heure où il naquit n'était ni pour notre pays, ni pour l'Europe, celle de la paix et de la justice. Depuis trente ans déjà, la Réforme agitait le vieux monde, qu'elle avait bouleversé en partie et qu'elle était à la veille de faire trembler sur ses bases. Luther, couché dans la tombe, avait fait son œuvre, qui fructifiait en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Hollande et, par contre-coup, en Angleterre. Calvin vivait encore, d'un esprit plus ardent et plus niveleur que son devancier; le «Pape de Genève» avait prêché et surtout suscité des prédicateurs en France. Politique autant que religieuse, la Réforme s'était heurtée aux impatiences de François Ier, qui sévit contre elle; mais, dès le début du règne de Henri II, elle avait reçu de ce prince des encouragements indirects par son alliance avec les princes luthériens d'Allemagne, soulevés contre Charles-Quint. La politique devrait être, ce semble, l'art de tout prévoir, et c'est presque toujours l'imprévu qui déconcerte ses desseins, paralyse ses actes et la met en péril. En donnant la main aux princes du Saint-Empire, Henri II avait oublié que la Réforme croissait et multipliait, par tolérance, dans ses propres Etats, parmi ses grands vassaux et ses capitaines, et jusque sur les marches du trône. Lorsque, plus tard, elle leva la tête au point qu'il fallut compter avec elle sur les champs de bataille, on doit avouer qu'elle avait, de son côté, tout au moins l'apparence du droit et de la logique. Les coquetteries d'esprit dont Marguerite de Valois l'avait honorée, l'intronisation de ses idées dans plusieurs pays, la contagion de l'exemple, la séduction des triomphes voisins, et enfin l'alliance aventureuse, quoique momentanée, de Henri II avec les luthériens couronnés, c'était plus qu'il n'en fallait pour lui révéler sa force d'expansion et lui dicter de hautes entreprises. Tout l'appelait au combat, et elle en cherchait vaguement le chemin, au moment où Jeanne d'Albret, qui devait être une de ses héroïnes, marquait du sceau catholique le front de son fils.