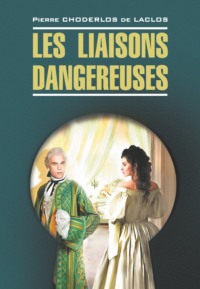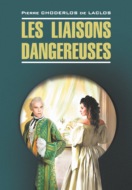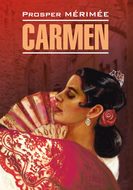Loe raamatut: «Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке»
TOME PREMIER
AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR
Nous croyons devoir prévenir le public, que, malgré le titre de cet ouvrage et ce qu’en dit le rédacteur dans sa préface, nous ne garantissons pas l’authenticité de ce recueil, et que nous avons même de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un roman.
Il nous semble de plus que l’auteur, qui paraît pourtant avoir cherché la vraisemblance, l’a détruite lui-même, et bien maladroitement, par l’époque où il a placé les événements qu’il publie. En effet, plusieurs des personnages qu’il met en scène ont de si mauvaises mœurs, qu’il est impossible de supposer qu’ils aient vécu dans notre siècle ; dans ce siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si modestes et si réservées.
Notre avis est donc que si les aventures rapportées dans cet ouvrage ont un fond de vérité, elles n’ont pu arriver que dans d’autres lieux ou dans d’autres temps, et nous blâmons beaucoup l’auteur, qui, séduit apparemment par l’espoir d’intéresser davantage en se rapprochant plus de son siècle et de son pays, a osé faire paraître, sous notre costume et avec nos usages, des mœurs qui nous sont si étrangères.
Pour préserver au moins, autant qu’il est en nous, le lecteur trop crédule de toute surprise à ce sujet, nous appuierons notre opinion d’un raisonnement que nous lui proposons avec confiance, parce qu’il nous paraît victorieux et sans réplique ; c’est que sans doute les mêmes causes ne manqueraient pas de produire les mêmes effets ; que cependant nous ne voyons point aujourd’hui de demoiselle, avec soixante mille livres de rente, se faire religieuse, ni de Présidente, jeune et jolie, mourir de chagrin.
PRÉFACE DU RÉDACTEUR
Cet ouvrage, ou plutôt ce recueil, que le Public trouvera peut-être encore trop volumineux, ne contient pourtant que le plus petit nombre des lettres qui composaient la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargé de la mettre en ordre par les personnes à qui elle était parvenue, et que je savais dans l’intention de la publier, je n’ai demandé, pour prix de mes soins, que la permission d’élaguer tout ce qui me paraîtrait inutile ; et j’ai tâché de ne conserver en effet que les lettres qui m’ont paru nécessaires, soit à l’intelligence des événements soit au développement des caractères. Si l’on ajoute à ce léger travail, celui de replacer par ordre les lettres que j’ai laissé subsister, ordre pour lequel j’ai même presque toujours suivi celui des dates, et enfin quelques notes courtes et rares, et qui, pour la plupart, n’ont d’autre objet que d’indiquer la source de quelques citations, ou de motiver quelques-uns des retranchements que je me suis permis, on saura toute la part que j’ai eue à cet ouvrage. Ma mission ne s’étendait pas plus loin1.
J’avais proposé des changements plus considérables, et presque tous relatifs à la pureté de diction ou de style, contre laquelle on trouvera beaucoup de fautes. J’aurais désiré aussi être autorisé à couper quelques lettres trop longues et dont plusieurs traitent séparément, et presque sans transition, d’objets tout à fait étrangers l’un à l’autre. Ce travail, qui n’a pas été accepté, n’aurait pas suffi sans doute pour donner du mérite à l’ouvrage, mais en aurait au moins ôté une partie des défauts.
On m’a objecté que c’étaient les lettres mêmes qu’on voulait faire connaître, et non pas seulement un ouvrage fait d’après ces lettres ; qu’il serait autant contre la vraisemblance que contre la vérité, que de huit à dix personnes qui ont concouru à cette correspondance, toutes eussent écrit avec une égale pureté. Et sur ce que j’ai représenté que, loin de là, il n’y en avait au contraire aucune qui n’eût fait des fautes graves, et qu’on ne manquerait pas de critiquer, on m’a répondu que tout lecteur raisonnable s’attendrait sûrement à trouver des fautes dans un recueil de lettres de quelques particuliers, puisque dans tous ceux publiés jusqu’ici de différents auteurs estimés, et même de quelques cadémiciens, on n’en trouvait aucun totalement à l’abri de ce reproche. Ces raisons ne m’ont pas persuadé, et je les ai trouvées, comme je les trouve encore, plus faciles à donner qu’à recevoir ; mais je n’étais pas le maître, et je me suis soumis. Seulement je me suis réservé de protester contre, et de déclarer que ce n’était pas mon avis ; ce que je fais en ce moment.
Quant au mérite que cet ouvrage peut avoir, peut-être ne m’appartient-il pas de m’en expliquer, mon opinion ne devant ni ne pouvant influer sur celle de personne. Cependant ceux qui, avant de commencer une lecture, sont bien aises de savoir à peu près sur quoi compter ; ceux-là, dis-je, peuvent continuer : les autres feront mieux de passer tout de suite à l’ouvrage même ; ils en savent assez.
Ce que je puis dire d’abord, c’est que si mon avis a été, comme j’en conviens, de faire paraître ces lettres, je suis pourtant bien loin d’en espérer le succès : et qu’on ne prenne pas cette sincérité de ma part pour la modestie jouée d’un auteur ; car je déclare avec la même franchise que si ce recueil ne m’avait pas paru digne d’être offert au Public, je ne m’en serais pas occupé. Tâchons de concilier cette apparente contradiction.
Le mérite d’un ouvrage se compose de son utilité ou de son agrément, et même de tous deux, quand il en est susceptible : mais le succès, qui ne prouve pas toujours le mérite, tient souvent davantage au choix du sujet qu’à son exécution, à l’ensemble des objets qu’il présente, qu’à la manière dont ils sont traités. Or ce recueil contenant, comme son titre l’annonce, les lettres de toute une société, il y règne une diversité d’intérêts qui affaiblit celui du Lecteur. De plus, presque tous les sentiments qu’on y exprime, étant feints ou dissimulés, ne peuvent même exciter qu’un intérêt de curiosité toujours bien au dessous de celui de sentiment, qui, surtout, porte moins à l’indulgence et laisse d’autant plus apercevoir les fautes qui s’y trouvent dans les détails, que ceux-ci s’opposent sans cesse au seul désir qu’on veuille satisfaire.
Ces défauts sont peut-être rachetés, en partie, par une qualité qui tient de même à la nature de l’ouvrage : c’est la variété des styles, mérite qu’un auteur atteint difficilement, mais qui se présentait ici de lui-même et qui sauve au moins l’ennui de l’uniformité. Plusieurs personnes pourront compter encore pour quelque chose un assez grand nombre d’observations, ou nouvelles, ou peu connues, et qui se trouvent éparses dans ces lettres. C’est aussi là, je crois, tout ce qu’on y peut espérer d’agréments, en les jugeant même avec la plus grande faveur.
L’utilité de l’ouvrage, qui peut-être sera encore plus contestée, me paraît pourtant plus facile à établir. Il me semble au moins que c’est rendre un service aux mœurs, que de dévoiler les moyens qu’emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes, et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce but. On y trouvera aussi la preuve et l’exemple de deux vérités importantes qu’on pourrait croire méconnues, en voyant combien peu elles sont pratiquées : l’une, que toute femme qui consent à recevoir dans sa société un homme sans mœurs, finit par en devenir la victime ; l’autre, que toute mère est au moins imprudente, qui souffre qu’une autre qu’elle ait la confiance de sa fille. Les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe, pourraient encore y apprendre que l’amitié que les personnes de mauvaises mœurs paraissent leur accorder si facilement, n’est jamais qu’un piège dangereux, et aussi fatal à leur bonheur qu’à leur vertu. Cependant l’abus, toujours si près du bien, me paraît ici trop à craindre ; et, loin de conseiller cette lecture à la jeunesse, il me paraît très important d’éloigner d’elle toutes celles de ce genre. L’époque où celle-ci peut cesser d’être dangereuse et devenir utile, me paraît avoir été très bien saisie, pour son sexe, par une bonne mère, qui non seulement a de l’esprit, mais qui a du bon esprit. « Je croirais », me disait-elle, après avoir lu le manuscrit de cette correspondance, « rendre un vrai service à ma fille, en lui donnant ce livre le jour de son mariage. » Si toutes les mères de famille en pensent ainsi, je me féliciterai éternellement de l’avoir publié.
Mais, en partant encore de cette supposition favorable, il me semble toujours que ce recueil doit plaire à peu de monde. Les hommes et les femmes dépravés auront intérêt à décrier un ouvrage qui peut leur nuire, et comme ils ne manquent pas d’adresse, peut-être auront-ils celle de mettre dans leur parti les rigoristes, alarmés par le tableau des mauvaises mœurs qu’on n’a pas craint de présenter.
Les prétendus esprits forts ne s’intéresseront point à une femme dévote, que par cela même ils regarderont comme une femmelette, tandis que les dévots se fâcheront de voir succomber la vertu et se plaindront que la Religion se montre avec trop peu de puissance.
D’un autre côté, les personnes d’un goût délicat seront dégoûtées par le style trop simple et trop fautif de plusieurs de ces lettres ; tandis que le commun des Lecteurs, séduit par l’idée que tout ce qui est imprimé est le fruit d’un travail, croira voir dans quelques autres la manière peinée d’un auteur qui se montre derrière le personnage qu’il fait parler.
Enfin on dira peut-être assez généralement, que chaque chose ne vaut qu’à sa place, et que si d’ordinaire le style trop châtié des auteurs ôte en effet de la grâce aux lettres de société, les négligences de celles-ci deviennent de véritables fautes, et les rendent insupportables quand on les livre à l’impression.
J’avoue avec sincérité que tous ces reproches peuvent être fondés : je crois aussi qu’il me serait possible d’y répondre, et même sans excéder la longueur d’une préface ; mais on doit sentir que pour qu’il fût nécessaire de répondre à tout, il faudrait que l’ouvrage ne pût répondre à rien; et que si j’en avais jugé ainsi, j’aurais supprimé à la fois la préface et le livre.
Lettre Première. Cécile Volanges à Sophie Carnay
aux Ursulines de…
Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps ; il m’en restera toujours pour toi. J’ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les quatre ans que nous avons passés ensemble, et je crois que la superbe Tanville2 aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu’elle n’a cru nous en faire toutes les fois qu’elle est venue nous voir in fiocchi. Maman m’a consultée sur tout ; et elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J’ai une femme de chambre à moi ; j’ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t’écris à un secrétaire très joli, dont on m’a remis la clef, et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m’a dit que je la verrais tous les jours à son lever ; qu’il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seules, et qu’alors elle me dirait chaque jour l’heure où je devrais l’aller joindre l’après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j’ai ma harpe, mon dessin, et des livres comme au couvent ; si ce n’est que la Mère Perpétue n’est pas là pour me gronder, et qu’il ne tiendrait qu’à moi d’être toujours sans rien faire : mais comme je n’ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j’aime autant m’occuper.
Il n’est pas encore cinq heures ; je ne dois aller retrouver Maman qu’à sept ; voilà bien du temps, si j’avais quelque chose à te dire ! Mais on ne m’a encore parlé de rien ; et sans les apprêts que je vois faire, et la quantité d’ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu’on ne songe pas à me marier, et que c’est un radotage de plus de la bonne Joséphine3. Cependant Maman m’a dit si souvent qu’une demoiselle devait rester au couvent jusqu’à ce qu’elle se mariât, que puisqu’elle m’en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison.
Il vient d’arrêter un carrosse à la porte, et Maman me fait dire de passer chez elle, tout de suite. Si c’était le Monsieur ? Je ne suis pas habillée, la main me tremble et le cœur me bat. J’ai demandé à la femme de chambre, si elle savait qui était chez ma mère : « Vraiment, m’a-t-elle dit, c’est M. C***. » Et elle riait. Oh ! je crois que c’est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu, jusqu’à un petit moment.
Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile ! Oh ! j’ai été bien honteuse ! Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez Maman, j’ai vu un Monsieur en noir, debout auprès d’elle. Je l’ai salué du mieux que j’ai pu, et suis restée sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l’examinais ! « Madame », a-t-il dit à ma mère, en me saluant, « voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. » À ce propos si positif, il m’a pris un tremblement tel, que je ne pouvais me soutenir ; j’ai trouvé un fauteuil, et je m’y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J’y étais à peine, que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête ; j’étais, comme a dit Maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant ; … tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d’un éclat de rire, en me disant : « Eh bien ! qu’avez-vous ? Asseyez-vous, et donnez votre pied à Monsieur. » En effet, ma chère amie, le Monsieur était un cordonnier : je ne peux te rendre combien j’ai été honteuse ; par bonheur il n’y avait que Maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là.
Conviens que nous voilà bien savantes ! Adieu. Il est près de six heures, ma femme de chambre dit qu’il faut que je m’habille. Adieu, ma chère Sophie ; je t’aime comme si j’étais encore au couvent.
P. S. Je ne sais par qui envoyer ma lettre : ainsi j’attendrai que Joséphine vienne.
Paris, ce 3 août 17**.
Lettre II. La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont
Au château de…
Revenez, mon cher Vicomte, revenez : que faites-vous, que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués ? Partez sur-le-champ ! j’ai besoin de vous. Il m’est venu une excellente idée, et je veux bien vous en confier l’exécution. Ce peu de mots devrait suffire ; et, trop honoré de mon choix, vous devriez venir, avec empressement, prendre mes ordres à genoux : mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n’en usez plus ; et dans l’alternative d’une haine éternelle ou d’une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l’emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets : mais jurez-moi qu’en fidèle Chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n’ayez mis celle-ci à fin. Elle est digne d’un héros : vous servirez l’amour et la vengeance ; ce sera enfin une rouerie4 de plus à mettre dans vos Mémoires : oui, dans vos Mémoires, car je veux qu’ils soient imprimés un jour, et je me charge de les écrire. Mais laissons cela, et revenons à ce qui m’occupe.
Madame de Volanges marie sa fille : c’est encore un secret ! mais elle m’en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu’elle ait choisi pour gendre ? le Comte de Gercourt. Qui m’aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt ? J’en suis dans une fureur !… Eh bien ! vous ne devinez pas encore ? oh ! l’esprit lourd ! Lui avez-vous donc pardonné l’aventure de l’Intendante ? Et moi, n’ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes5 ?
Mais je m’apaise, et l’espoir de me venger rassérène mon âme.
Vous avez été ennuyé cent fois, ainsi que moi, de l’importance que met Gercourt à la femme qu’il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu’il évitera le sort inévitable. Vous connaissez sa ridicule prévention pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que, malgré les soixante mille livres de rente de la petite Volanges, il n’aurait jamais fait ce mariage, si elle eût été brune, ou si elle n’eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu’il n’est qu’un sot ; il le sera sans doute un jour ; ce n’est pas là ce qui m’embarrasse : mais le plaisant serait qu’il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l’entendant se vanter ! car il se vantera ; et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris.
Au reste, l’Héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins :elle est vraiment jolie ! cela n’a que quinze ans, c’est le bouton de rose ; gauche, à la vérité, comme on ne l’est point, et nullement maniérée : mais, vous autres hommes, vous ne craignez pas cela ; de plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité ; ajoutez-y que je vous la recommande ; vous n’avez plus qu’à me remercier et m’obéir.
Vous recevrez cette lettre demain matin. J’exige que demain, à sept heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu’à huit, pas même le régnant Chevalier : il n’a pas assez de tête pour une si grande affaire. Vous voyez que l’amour ne m’aveugle pas. À huit heures je vous rendrai votre liberté, et vous reviendrez à dix souper avec le bel objet ; car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu, il est midi passé : bientôt je ne m’occuperai plus de vous.
Paris, ce 4 août 17**.
Lettre III. Cécile Volanges à Sophie Carnay
Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l’intérêt que j’avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m’a beaucoup regardée, et puis on se parlait à l’oreille ; et je voyais bien qu’on parlait de moi : cela me faisait rougir ; je ne pouvais m’en empêcher. Je l’aurais bien voulu, car j’ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas ; ou bien c’est le rouge qu’elles mettent, qui empêche de voir celui que l’embarras leur cause ; car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement.
Ce qui m’inquiétait le plus était de ne pas savoir ce qu’on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant deux ou trois fois le mot de jolie ; mais j’ai entendu bien distinctement celui de gauche ; et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère ; elle paraît même avoir pris tout de suite de l’amitié pour moi. C’est la seule personne qui m’ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle.
J’ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûre qui parlait de moi, et qui disait à un autre : « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C’est peut-être celui-là qui doit m’épouser ; mais alors ce ne serait donc que dans quatre mois ! Je voudrais bien savoir ce qui en est.
Voilà Joséphine, et elle me dit qu’elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh ! je crois que cette dame a raison.
Après le souper on s’est mis à jouer. Je me suis placée auprès de Maman ; je ne sais pas comment cela s’est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m’a réveillée. Je ne sais si l’on riait de moi, mais je le crois. Maman m’a permis de me retirer, et elle m’a fait grand plaisir. Figure-toi qu’il était onze heures passées. Adieu, ma chère Sophie ; aime toujours bien ta Cécile. Je t’assure que le monde n’est pas aussi amusant que nous l’imaginions.
Paris, ce 4 août 17**.
Lettre IV. Le Vicompte Valmont à la Marquise de Merteuil à Paris
Vos ordres sont charmants ; votre façon de les donner est plus aimable encore ; vous feriez chérir le despotisme. Ce n’est pas la première fois, comme vous savez, que je regrette de ne plus être votre esclave ; et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m’honoriez de noms plus doux. Souvent même je désire de les mériter de nouveau, et de finir par donner, avec vous, un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent ; conquérir est notre destin ; il faut le suivre : peut-être au bout de la carrière nous rencontrerons-nous encore ; car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle Marquise, vous me suivez au moins d’un pas égal, et depuis que, nous séparant pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d’amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur ; et si ce Dieu-là nous jugeait sur nos Œuvres, vous seriez un jour la Patronne de quelque grande ville, tandis que votre ami serait au plus un Saint de village. Ce langage vous étonne, n’est-il pas vrai ? Mais depuis huit jours, je n’en entends, je n’en parle pas d’autre ; et c’est pour m’y perfectionner, que je me vois forcé de vous désobéir.
Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j’aie jamais formé. Que me proposez-vous ? de séduire une jeune fille qui n’a rien vu, ne connaît rien ; qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense ; qu’un premier hommage ne manquera pas d’enivrer, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l’amour. Vingt autres peuvent y réussir comme moi. Il n’en est pas ainsi de l’entreprise qui m’occupe ; son succès m’assure autant de gloire que de plaisir. L’amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier, ou plutôt il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d’un saint respect, et vous direz avec enthousiasme : « Voilà l’homme selon mon cœur. »
Vous connaissez la Présidente de Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j’attaque ; voilà l’ennemi digne de moi ; voilà le but où je prétends atteindre :
Et si de l’obtenir je n’emporte le prix,
J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.
On peut citer de mauvais vers, quand ils sont d’un grand poëte6.
Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d’un grand procès (j’espère lui en faire perdre un plus important). Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin au soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste wist, devaient être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m’a conduit ici, pour son bonheur et pour le mien. Insensé ! je regrettais vingt-quatre heures que je sacrifiais à des égards d’usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris ! Heureusement il faut être quatre pour jouer au whist ; et, comme il n’y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m’a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j’ai consenti. Vous n’imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment, combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j’y adore.
Me voilà donc, depuis quatre jours, livré à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles : mais ce que vous ignorez, c’est combien la solitude ajoute à l’ardeur du désir. Je n’ai plus qu’une idée ; j’y pense le jour, et j’y rêve la nuit. J’ai bien besoin d’avoir cette femme, pour me sauver du ridicule d’en être amoureux : car où ne mène pas un désir contrarié ! O délicieuse jouissance ! je t’implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal ! nous ne serions auprès d’elles que de timides esclaves. J’ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles, qui m’amène naturellement à vos pieds. Je m’y prosterne pour obtenir mon pardon, et j’y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie : sans rancune.
Du château de…, ce 5 août 17**.