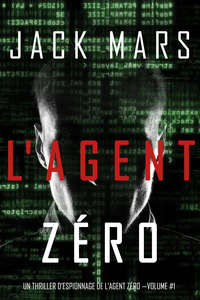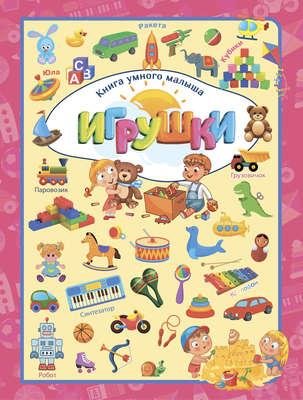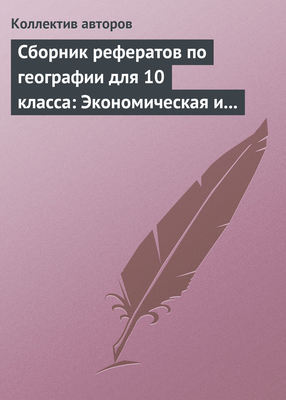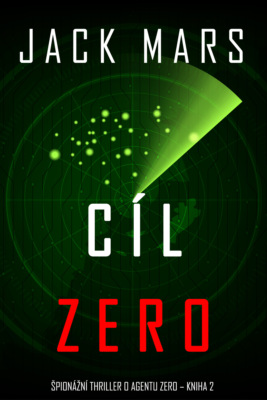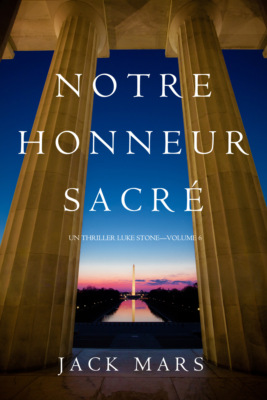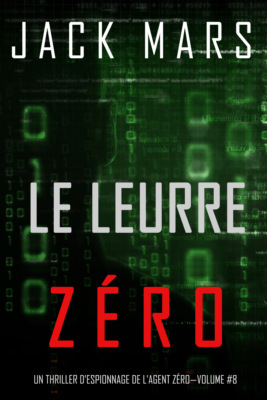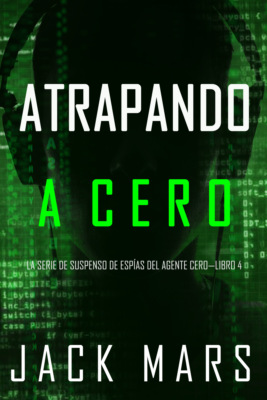Loe raamatut: «L'Agent Zéro »
L’A G E N T Z É R O
(THRILLER D’ESPIONNAGE L’AGENT ZÉRO—VOLUME 1)
J A C K M A R S
Jack Mars
Jack Mars est actuellement l’auteur best-seller aux USA de la série de thrillers LUKE STONE, qui contient sept volumes. Il a également écrit la nouvelle série préquel FORGING OF LUKE STONE, ainsi que la série de thrillers d’espionnage L’AGENT ZÉRO.
Jack adore avoir vos avis, donc n’hésitez pas à vous rendre sur www.Jackmarsauthor.com afin d’ajouter votre mail à la liste pour recevoir un livre offert, ainsi que des invitations à des concours gratuits. Suivez l’auteur sur Facebook et Twitter pour rester en contact !
Copyright © 2019 par Jack Mars. Tous droits réservés. À l’exclusion de ce qui est autorisé par l’U.S. Copyright Act de 1976, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous toute forme que ce soit ou par aucun moyen, ni conservée dans une base de données ou un système de récupération, sans l’autorisation préalable de l’auteur. Ce livre numérique est prévu uniquement pour votre plaisir personnel. Ce livre numérique ne peut pas être revendu ou offert à d’autres personnes. Si vous voulez partager ce livre avec quelqu’un d’autre, veuillez acheter un exemplaire supplémentaire pour chaque destinataire. Si vous lisez ce livre sans l’avoir acheté, ou qu’il n’a pas été acheté uniquement pour votre propre usage, alors veuillez le rendre et acheter votre propre exemplaire. Merci de respecter le dur labeur de cet auteur. Il s’agit d’une œuvre de fiction. Les noms, personnages, entreprises, organismes, lieux, événements et incidents sont tous le produit de l’imagination de l’auteur et sont utilisés de manière fictive. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, n’est que pure coïncidence.
Image de couverture : Copyright GlebSStock, utilisée sous licence à partir de Shutterstock.com.
LIVRES DE JACK MARS
SÉRIE DE THRILLERS LUKE STONE
TOUS LES MOYENS NÉCESSAIRES (Volume #1)
SÉRIE D’ESPIONNAGE L’AGENT ZÉRO
L’AGENT ZÉRO (Volume #1)
LA CIBLE ZÉRO (Volume #2)
LA TRAQUE ZÉRO (Volume #3)
LE PIÈGE ZÉRO (Volume #4)
LE FICHIER ZÉRO (Volume #5)
LE SOUVENIR ZÉRO (Volume #6)
CONTENU
CHAPITRE UN
CHAPITRE DEUX
CHAPITRE TROIS
CHAPITRE QUATRE
CHAPITRE CINQ
CHAPITRE SIX
CHAPITRE SEPT
CHAPITRE HUIT
CHAPITRE NEUF
CHAPITRE DIX
CHAPITRE ONZE
CHAPITRE DOUZE
CHAPITRE TREIZE
CHAPITRE QUATORZE
CHAPITRE QUINZE
CHAPITRE SEIZE
CHAPITRE DIX-SEPT
CHAPITRE DIX-HUIT
CHAPITRE DIX-NEUF
CHAPTER VINGT
CHAPITRE VINGT-ET-UN
CHAPITRE VINGT-DEUX
CHAPITRE VINGT-TROIS
CHAPITRE VINGT-QUATRE
CHAPTITRE VINGT-CINQ
CHAPITRE VINGT-SIX
CHAPITRE VINGT-SEPT
CHAPITRE VINGT-HUIT
CHAPITRE VINGT-NEUF
CHAPITRE TRENTE
CHAPITRE TRENTE-ET-UN
CHAPITRE TRENTE-DEUX
CHAPITRE TRENTE-TROIS
CHAPITRE TRENTE-QUATRE
CHAPITRE TRENTE-CINQ
CHAPITRE TRENTE-SIX
CHAPITRE TRENTE-SEPT
CHAPITRE TRENTE-HUIT
ÉPILOGUE
“La vie des morts consiste à survivre dans l’esprit des vivants.”
—Cicéron
CHAPITRE UN
Le premier cours de la journée était toujours le plus difficile. Les étudiants s’amassaient dans l’amphithéâtre de l’Université de Columbia comme des zombies désœuvrés aux yeux mornes, leurs sens alanguis par leurs sessions de révisions nocturnes, leur gueule de bois, voire même un mélange des deux. Ils portaient des pantalons de survêtement et les tee-shirts de la veille. En main, ils tenaient des tasses en polystyrène contenant du moka au soja, du café blond artisanal ou toute autre boisson à la mode que buvaient les jeunes actuellement.
Le boulot du professeur Reid Lawson était d’enseigner, bien sûr, mais on lui reconnaissait également la capacité de stimulant matinal : un bon complément à la caféine. Lawson leur laissa un moment pour prendre place et s’installer confortablement sur leurs sièges, pendant qu’il enlevait son blouson en tweed et le passait par-dessus sa chaise.
“Bonjour à tous,” dit-il bruyamment. Cette annonce prit de court plusieurs étudiants qui levèrent soudain les yeux, comme s’ils n’avaient pas réalisé qu’ils avaient atterri dans une salle de cours. “Aujourd’hui, nous allons parler des pirates.”
Cette phrase lui valut d’attirer l’attention. Les yeux se tournèrent vers lui, clignant à cause du manque de sommeil, essayant de déterminer s’il avait bien dit “pirates” ou pas.
“Des Caraïbes ?” plaisanta un étudiant au premier rang.
“De la Méditerranée en fait,” corrigea Lawson. Il se mit à marcher lentement, mains jointes derrière son dos. “Combien d’entre vous ont assisté aux cours du professeur Truitt sur les anciens empires ?” Environ un tiers de la classe leva la main. “Bien. Alors vous savez que l’Empire Ottoman fut une puissance mondiale majeure pendant, oh, disons près de six cents ans. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les corsaires ottomans, plus familièrement appelés les pirates barbares, ont sillonné presque toute la Méditerranée pendant quasiment toute cette période, en partant des côtes du Portugal et en passant par le détroit de Gibraltar. Que pensez-vous qu’ils cherchaient ? Quelqu’un ? Je sais que vous êtes vivants dans le fond.”
“De l’argent ?” demanda une fille au troisième rang.
“Un trésor,” surenchérit l’étudiant du premier rang.
“Du rhum !” cria un étudiant dans le fond, récoltant un rire général. Reid esquissa également un sourire. Finalement, il y avait de la vie dans cette masse d’étudiants.
“Que de bonnes déductions,” dit-il. “La réponse est ‘Tout ça à la fois.’ Vous voyez, les pirates barbares prenaient principalement pour cibles les navires de marchandises européens pour les piller totalement. Je dis bien totalement : chaussures, ceintures, argent, chapeaux, marchandises, le bateau lui-même… et son équipage. On pense qu’en l’espace de deux siècles, de 1580 à 1780, les pirates barbares ont capturé et asservi plus de deux millions de personnes. Ils ramenaient tout ça dans leur royaume d’Afrique du Nord. Cela a duré des siècles. Et que croyez-vous que les nations européennes aient fait en retour ?”
“La guerre !” cria l’étudiant du fond.
Une fille souriante à lunettes leva légèrement la main pour poser sa question, “Est-ce qu’ils ont négocié un pacte ou un traité ?”
“On pourrait dire ça comme ça,” répondit Lawson. “Les puissances d’Europe ont accepté de payer un tribut aux nations barbares, sous forme de grosses quantités d’argent et de marchandises. Je parle là du Portugal, de l’Espagne, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, de la Suède, des Pays-Bas… Ils payaient tous les pirates pour les tenir à distance de leurs bateaux. Les riches se sont encore enrichis et les pirates sont partis pour la plupart. Mais ensuite, entre la fin du dix-huitième et le début du dix-neuvième siècle, il s’est produit une chose. Un événement a entraîné la fin des pirates barbare. Quelqu’un à une idée de ce qui s’est produit ?”
Personne n’ouvrit la bouche. À sa droite, Lawson aperçut un jeune pianoter sur son téléphone.
“M. Lowell,” dit-il. L’étudiant releva la tête. “Une idée ?”
“Euh… la création des États-Unis ?”
Lawson sourit. “Est-ce que vous me posez la question ou est-ce que c’est une affirmation de votre part ? Ayez confiance en vos réponses et le reste de la classe sera au moins en mesure de penser que vous savez ce dont vous parlez.”
“La création des États-Unis,” dit-il de nouveau, d’un ton plus énergique cette fois.
“Tout à fait ! Les États-Unis furent créés. Mais, comme vous le savez, notre nation n’en était alors qu’à ses balbutiements Les États-Unis étaient plus jeunes que la plupart d’entre vous aujourd’hui. Nous devions établir des routes commerciales avec l’Europe pour booster notre économie, mais les pirates barbares commencèrent à prendre nos bateaux. Et quand nous leur avons demandé ‘C’est quoi ce bazar, les gars ?’, ils nous ont répondu de payer un tribut. Nous venions à peine d’établir une trésorerie, si tant est qu’il y ait quelque chose dedans. Notre tirelire était vide. Alors quel choix avions-nous ? Que pouvions-nous faire ?”
“Déclarer la guerre !” cria une voix familière dans le fond de la salle.
“Exactement ! Nous n’avions pas d’autre choix que de déclarer la guerre. À l’époque, cela faisait déjà un an que la Suède se battait contre les pirates et, ensemble, entre 1801 et 1805, nous prîmes le port de Tripoli et envahirent la ville de Derne, mettant enfin un terme au conflit.” Lawson se pencha en avant et replia ses mains face à lui, sur le rebord de son bureau. “Bien sûr, je vous passe tout un tas de détails, mais il s’agit d’un cours sur l’histoire de l’Europe, pas sur celle des États-Unis. Si vous en avez l’occasion, faites un brin de lecture à propos du Lieutenant Stephen Decatur et de l’USS Philadelphia. Mais je m’égare. Pourquoi parlions-nous des pirates au fait ?”
“Parce que les pirates sont cool ?” dit Lowell, qui avait décidé pour de bon de délaisser son téléphone.
Lawson rigola. “J’avoue que ce n’est pas faux. Mais non, il ne s’agit pas de ça. Nous parlons des pirates parce qu’il y a, dans la Guerre de Tripoli, quelque chose que l’on a rarement vu dans les annales de l’histoire.” Il se redressa d’un coup en parcourant des yeux la salle, croisant au passage le regard de plusieurs étudiants. Au mois, à présent, Lawson pouvait voir leurs yeux s’éclairer, preuve que la plupart des étudiants étaient vivants ce matin, si ce n’est attentifs. “Pendant plusieurs siècles, aucune puissance européenne ne s’était aventurée à s’opposer aux nations barbares. Il était plus facile de se contenter de payer. Et ce furent les États-Unis, alors considérés comme une simple blague pour la plupart du monde développé, qui initièrent le changement. Il fallut un acte de désespoir émanant d’une nation à l’armée ridicule et mal armée pour instaurer une transition dans la dynamique de puissance de la route commerciale qui avait le plus de valeur à l’époque. Et quelle leçon pouvons-nous en tirer ?”
“On ne rigole pas avec les États-Unis ?” proposa quelqu’un.
Lawson sourit. “Voilà, c’est ça.” Il leva un doigt en l’air pour ponctuer sa phrase. “Et au-delà de ça, ce désespoir et ce cruel manque d’autre choix possibles peut, et a déjà dans l’histoire, conduit à certaines des plus grandes victoires que le monde ait pu connaître. L’histoire nous a enseigné à maintes reprises qu’il n’existe pas de régime trop puissant qui ne puisse être renversé, pas de pays trop petit ou trop faible pour faire réellement la différence.” Il décocha un clin d’œil à l’assemblée. “Pensez-y la prochaine fois que vous aurez l’impression de n’être rien de plus qu’un minuscule grain de poussière dans ce monde.”
À la fin du cours, on pouvait remarquer la différence notable entre les étudiants fatigués et à la traîne qui étaient entrés dans la classe et ce même groupe de jeunes en train de quitter la salle en rigolant et papotant. Une fille aux cheveux roses s’arrêta devant son bureau avec un sourire pour commenter le cours, “Chouette discours, Professeur. Pouvez-vous me rappeler le nom du lieutenant américain que vous avez mentionné ?”
“Oh, il s’agit de Stephen Decatur.”
“Merci.” Elle le nota avant de presser le pas pour sortir de l’amphi.
“Professeur ?”
Lawson leva les yeux. C’était l’étudiant du premier rang. “Oui, M. Garner ? Que puis-je faire pour vous ?”
“Je me disais, est-ce que je peux vous demander un service ? Je suis candidat pour un stage au Musée d’Histoire Naturelle et, euh, ce serait bien si je pouvais avoir une lettre de recommandation.”
“Bien sûr, aucun souci. Mais votre spécialité n’est-elle pas l’anthropologie ?”
“Si. Mais, euh, je me disais qu’une lettre de votre part pourrait avoir un peu plus d’impact, vous voyez ? Et, euh…” Le jeune homme regarda ses pieds. “Ce cours est celui que je préfère.”
“Pour l’instant, en tout cas.” dit Lawson avec un sourire. “Je serai ravis de vous aider. Je vous la prépare pour demain… Oh, en fait, j’ai un rendez-vous important que je ne peux pas rater ce soir. Pour vendredi, ça vous va ?”
“Pas d’urgence. Vendredi, ce sera très bien. Merci, Professeur. À très vite !” Garner se dépêcha de quitter la salle, laissant Lawson seul.
Il parcourut du regard l’amphithéâtre désormais vide. C’était son moment favori de la journée, entre les cours… Cette satisfaction provenant du cours précédant se mêlait à l’anticipation du suivant.
Une sonnerie de téléphone retentit soudain. C’était un SMS de Maya. RDV à la maison à 17h30 ?
OK, répondit-il. J’y serai. Le “rendez-vous important” de ce soir-là était de passer une soirée à jouer chez Lawson. Il savourait ces bons moments passés avec ses deux filles.
Cool, répondit sa fille. J’ai des trucs à te dire.
Quels trucs ?
Tout à l’heure fut sa seule réponse. Il fronça les sourcils en lisant ce vague message. Soudain, il sentit que la journée allait lui paraître très longue.
*
Une fois sa journée de cours achevée, Lawson rangea ses affaires dans sa sacoche, enfila son chaud manteau d’hiver et pressa le pas vers le parking. En février, à New York, le froid était généralement mordant et, récemment, cela n’avait fait qu’empirer. Le moindre petit coup de vent était littéralement glaçant.
Il démarra sa voiture et la laissa chauffer quelques minutes, portant ses mains à sa bouche pour souffler de l’air chaud sur ses doigts gelés. C’était le deuxième hiver qu’il passait à New York, et il ne semblait pas s’accoutumer à ce climat plus froid. En Virginie, il trouvait que quarante degrés, c’était glacial en février. Au moins, il ne neige pas, se dit-il. Un manteau d’argent.
La distance entre le campus de Columbia et son domicile n’était que de onze kilomètres, mais le trafic était dense à cette heure de la journée, et les autres usagers de la route étaient généralement énervants. Reid passait le temps grâce à des livres audio, astuce que lui avait récemment conseillée sa fille ainée. En ce moment, il écoutait Le Nom de la Rose d’Umberto Eco, bien qu’aujourd’hui, il entendait à peine les paroles. Il pensait au mystérieux message de Maya.
La maison de Lawson était en brique brune. C’était un petit pavillon à deux étages, typique de Riverdale, à l’extrémité nord du Bronx. Il adorait ce quartier suburbain bucolique, proche de la ville et de l’université, avec ses rues venteuses qui laissaient place au sud à un grand boulevard. Les filles l’aimaient beaucoup aussi et, si Maya était acceptée à Columbia, ou même à son école de repli à NYU, elle n’aurait pas besoin de quitter la maison.
Reid se rendit tout de suite compte que quelque chose avait changé quand il entra chez lui. Il le sentait dans l’air et, depuis le couloir, il entendit des voix chuchoter dans la cuisine. Il posa sa sacoche et retira en silence son manteau avant de se glisser sur la pointe des pieds en direction des voix.
“Mais qu’est-ce que vous trafiquez ici ?” demanda-t-il en guise de bonjour.
“Salut, Papa !” Sara, sa fille de quatorze ans, se hissait sur la pointe des pieds pour observer sa sœur ainée, Maya, en train de procéder à un rituel étrange sur un plat de cuisson en Pyrex. “On prépare le dîner !”
“Je prépare le dîner,” murmura Maya sans lever la tête. “Elle n’est que spectatrice.”
Les yeux de Reid clignèrent de surprise. “OK. J’ai quelques questions.” Il jeta un coup d’œil par-dessus l’épaule de Maya, alors qu’elle s’affairait à appliquer une sorte de laquage violacé sur une série de côtelette de porc en rang serré. “À commencer par… euh ?”
Maya n’avait toujours pas levé les yeux. “Ne me regarde pas comme ça,” dit-elle. “S’ils comptent faire de l’éducation domestique un cours obligatoire, il faut bien que ça me serve à quelque chose.” Elle finit par regarder son père avec un léger sourire. “Mais ne t’y habitue pas.”
Reid leva les mains en signe de défense. “Cela va de soi.”
Maya avait seize ans et elle était dangereusement intelligente. Elle avait clairement hérité de l’intellect de sa mère et serait déjà bachelière cette année, ayant sauté le huitième cycle. Elle possédait les cheveux noirs de Reid, un sourire pensif et un talent inné pour le dramatique. Sara, de son côté, ressemblait en tous points à Kate. Maintenant qu’elle devenait adolescente, Reid avait parfois de la peine en regardant son visage, même s’il ne le montrait jamais. Elle possédait également le tempérament fougueux de Kate. Alors que, la plupart du temps, Sara était un véritable amour, elle explosait parfois et les retombées pouvaient s’avérer dévastatrices.
Reid observa avec étonnement les filles mettre la table et servir le dîner. “Ce repas a l’air délicieux, Maya,” dit-il.
“Oh, attends. Il manque un truc.” Elle sortit quelque chose du frigo : une bouteille brune. “La belge est ta préférée, pas vrai ?”
Les yeux de Reid devinrent suspicieux. “Comment as-tu… ?”
“Ne t’en fais pas, c’est Tatie Linda qui l’a achetée.” Elle fit sauter la capsule et versa la bière dans un verre. “C’est bon. On peut manger maintenant.”
Reid avait de la veine que Linda, la sœur de Kate, ne vive qu’à quelques minutes de là. Gagner sa vie en tant que professeur, tout en élevant deux adolescentes, aurait été tout bonnement impossible sans elle. Sa présence avait été l’une des principales motivations pour venir s’installer à New York, afin que les filles aient un modèle féminin positif auprès d’elles. (Même s’il devait bien admettre ne pas être fan de l’idée que Linda puisse acheter de la bière à son adolescente, peu importe pour qui elle était destinée.)
“Maya, c’est vraiment très bon,” s’exclama-t-il dès la première bouchée.
“Merci. C’est un laquage mexicain chipotle.”
Il s’essuya la bouche, posa sa serviette et demanda, “Bon, c’est trop beau pour être honnête. Qu’est-ce que tu as fait ?”
“Quoi ? Mais rien du tout !” s’écria-t-elle.
“Alors, qu’est-ce que tu as cassé ?”
“Je n’ai rien…”
“Tu as été renvoyée ?”
“Papa, enfin…”
Reid saisit la table à deux mains de façon totalement mélodramatique. “Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es enceinte. Je n’ai même pas de fusil.”
Sara explosa de rire.
“Mais tu vas arrêter à la fin ?” souffla Maya. “J’ai le droit d’être gentille, tu sais.” Ils mangèrent en silence pendant environ une minute avant qu’elle ajoute innocemment, “Mais, maintenant que tu le dis…”
“Oh, bon sang. Nous y voilà.”
Elle se râcla la gorge et dit, “J’ai une sorte de rendez-vous. Pour la Saint Valentin.”
Reid faillit s’étouffer avec sa côtelette.
Sara fit la grimace. “Je te l’avais bien dit qu’il allait devenir bizarre.”
Une fois remis de ses émotions, il leva la main. “Attends, attends, je ne suis pas bizarre. C’est juste que je ne m’attendais pas… Je ne pensais pas que tu, euh… Tu as un petit copain ?”
“Non,” s’empressa de dire Maya. Puis, elle haussa les épaules et baissa les yeux vers son assiette. “Enfin peut-être. Je ne sais pas encore. Mais, c’est un mec sympa et il veut m’emmener dîner en ville…”
“En ville,” répéta Reid.
“Oui, Papa, en ville. Et il me faut une robe. C’est un endroit chic. Je n’ai pas grand-chose à me mettre.”
Maintes fois, Reid aurait désespérément eu besoin que Kate soit là, mais elle se serait peut-être sentie aussi dépassée que lui dans le cas présent. Il avait bien conscience que ses filles auraient des petits copains à un moment ou un autre, mais il espérait que ce ne serait pas le cas avant leurs vingt-cinq ans. C’était dans des moments pareils qu’il ressortait son acronyme parental fétiche, QDK : que dirait Kate ? En tant qu’artiste à l’esprit totalement libéré, elle gérerait certainement la situation bien différemment de lui, et il tâcha de garder ça à l’esprit.
Il devait avoir l’air particulièrement perturbé, car Maya eut un léger rire, et posa la main sur la sienne. “Tu es d’accord, Papa ? C’est juste un rencart. Il ne va rien se passer. Ce n’est pas la fin du monde.”
“Mouais,” dit-il doucement. “Tu as raison. C’est clair que ce n’est pas la fin du monde. Nous allons demander à Tante Linda si elle peut t’emmener au centre commercial ce week-end et…”
“Je préférerais que tu m’accompagnes.”
“Vraiment ?”
Elle haussa les épaules. “En fait, je ne veux pas porter quoi que ce soit que tu désapprouverais.”
Une robe, un dîner en ville et un certain garçon… ce n’était pas un truc qu’il aurait pensé devoir gérer de sitôt.
“Très bien,” dit-il. “Dans ce cas, nous irons ensemble samedi. Mais à une condition : c’est moi qui choisis le jeu ce soir.”
“Hum,” dit Maya. “Ce n’est pas rien comme contrepartie. Laisse-moi consulter mon associée d’abord.” Maya se retourna vers sa sœur.
Sara acquiesça. “OK, c’est d’accord, tant que tu ne choisis pas Risk.”
Reid prit un air moqueur. “Tu ne sais pas de quoi tu parles. Risk est le meilleur jeu qui existe.”
Après le dîner, Sara lava la vaisselle, pendant que Maya préparait du chocolat chaud. Reid opta pour l’un de ses jeux préférés, Ticket to Ride, un jeu classique consistant à construire des rails de train dans tous les États-Unis. Alors qu’il préparait les cartes et les wagons en plastique, il ne put s’empêcher de penser à comment il en était arrivé là. Comment Maya avait-elle pu grandir si vite ? Ces deux dernières années, depuis le décès de Kate, il avait joué le rôle des deux parents (avec l’aide précieuse de Tante Linda). Elles avaient encore besoin de lui toutes les deux, du moins le pensait-il, mais elles iraient dans peu de temps à l’université, puis elles auraient leurs carrières à mener, et ensuite…
“Papa ?” Sara entra dans la salle à manger et s’assit en face de lui. Comme si elle pouvait lire dans son esprit, elle lui dit, “N’oublie pas que j’ai une expo d’art à l’école mercredi soir prochain. Tu seras là, pas vrai ?”
Il sourit. “Bien sûr, ma chérie. Je ne voudrais pas rater ça.” Soudain, il tapa dans ses mains. “Bon ! Qui est prête à prendre sa râclée… Je veux dire, qui est prête à jouer à un jeu sympa en famille ?”
“Amène-toi, mon vieux,” cria Maya depuis la cuisine.
“Mon vieux ?” répéta Reid indigné. “J’ai trente-huit ans !”
“Je tâcherai de m’en rappeler.” Elle éclata de rire en pénétrant dans la pièce. “Oh, le jeu du train.” Son rire se transforma en léger sourire. “C’était le préféré de Maman, non ?”
“Oh… si.” Reid fronça les sourcils. “En effet.”
“Je prends les bleus !” annonça Sara en récupérant ses pièces.
“Orange,” dit Maya. “Papa, quelle couleur ? Allô, Papa ?”
“Oh.” Reid sortit de sa torpeur. “Désolé. Euh, vert.”
Maya poussa les pièces vertes vers lui. Reid s’efforça de sourire, même si son esprit était troublé.
*
Au bout de deux parties, toutes gagnées par Maya, les filles s’en allèrent au lit et Reid se retira dans son bureau, une petite pièce au premier étage, juste au-dessus de l’entrée.
Riverdale n’était pas un quartier bon marché, mais il avait semblé important pour Reid de s’assurer que ses filles soient dans un environnement sûr et agréable. Étant donné qu’il n’y avait que deux chambres, il avait revendiqué comme bureau la piaule du premier étage. Tous ses livres et ses souvenirs s’entassaient sur presque chaque centimètre carré disponible de cette pièce de 9m². Outre son bureau et un fauteuil en cuir, la seule chose encore visible était un petit tapis usé.
Il s’endormait souvent sur son fauteuil après de longues soirées à prendre des notes, préparer ses cours et relire des biographies. Il commençait d’ailleurs à avoir des problèmes de dos. Et, pour être tout à fait honnête, il ne dormait pas mieux dans son propre lit. Même s’il avait emménagé à New York avec les filles peu après la mort de Kate, il avait toujours le lit et le matelas King Size qui avait été le leur, à lui et à Kate.
Il aurait pu penser que la douleur d’avoir perdu Kate se serait estompée à présent, du moins légèrement. Parfois, c’était temporairement le cas mais, en passant devant sa chaîne de restaurants préférée ou en tombant sur l’un de ses films favoris à la télé, cette douleur revenait au galop, aussi vive que si ça s’était passé la veille.
Si les filles ressentaient la même chose, elles ne l’exprimaient jamais en tout cas. En fait, elles parlaient souvent d’elle ouvertement, chose que Reid était encore incapable de faire.
Il y avait une photo d’elle sur l’une de ses étagères, prise au mariage d’un ami une décennie plus tôt. Quasiment tous les soirs, il retournait le cadre, sans quoi il pourrait passer la nuit entière à le regarder.
Comme le monde pouvait être incroyablement injuste. Avant, ils avaient tout : une jolie maison, des filles géniales, de belles carrières. Ils vivaient à McLean, en Virginie. Il travaillait en tant que professeur adjoint à l’université voisine George Washington. Il voyageait beaucoup pour son travail, entre les séminaires et les congrès, en tant que lecteur invité sur l’histoire de l’Europe dans des écoles du pays entier. Kate faisait partie du département restauration du Musée d’Art Américain Smithsonian. Leurs filles étaient épanouies. La vie était parfaite
Mais, comme Robert Frost l’a si bien dit, l’or n’est en rien éternel. Un après-midi d’hiver, Kate s’était évanouie au travail, du moins c’est ce qu’avaient cru ses collèges quand elle s’était sentie faible et qu’elle était tombée de sa chaise. Ils avaient appelé une ambulance, mais il était déjà trop tard. Son décès avait été constaté en arrivant à l’hôpital. Une embolie, avaient-ils dit. Un caillot sanguin avait atteint son cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral ischémique. Les médecins utilisent souvent des termes médicaux à peine compréhensibles dans leurs explications, comme si cela pourrait altérer le choc de la douleur.
Et le pire, c’était que Reid était en voyage quand cela s’était produit. Il était à un séminaire pour étudiants de premier cycle, à Houston au Texas, en train de faire des discours sur le Moyen Âge, quand il avait reçu le coup de fil.
C’est comme ça qu’il avait appris la mort de sa femme. Un coup de téléphone, juste devant la porte d’une salle de conférence. Puis était venu le vol de retour, les tentatives de consoler ses filles au beau milieu de sa propre douleur dévastatrice et, enfin, le déménagement à New York.
Il se leva de son fauteuil et retourna la photo. Il n’aimait pas penser à tout ça, à la fin et à l’après. Il voulait se rappeler d’elle ainsi, sur la photo, Kate dans toute sa splendeur. C’est pourquoi il avait choisi de se souvenir.
Il y avait autre chose, une chose dont il avait à peine conscience, une sorte de souvenir brumeux qui tentait de refaire surface alors qu’il regardait la photo. C’était presque comme une sensation de déjà vu, mais pas du moment présent. C’était comme si son subconscient essayait de lui dire quelque chose.
Il revint soudain à la réalité en entendant frapper à la porte. Reid resta interdit, se demandant bien qui cela pouvait être. Il était presque minuit et les filles étaient au lit depuis deux heures déjà. On frappa de nouveau. Craignant que les filles ne se réveillent, il se hâta d’aller répondre. Après tout, il vivait dans un quartier sûr et n’avait aucune raison d’avoir peur d’ouvrir la porte, qu’il soit minuit ou non.
Ce ne fut pas le cinglant vent d’hiver qui lui glaça le sang. Il observa avec surprise les trois hommes sur le pas de sa porte. Ils étaient certainement du Moyen Orient, chacun d’entre eux ayant la peau sombre, une barbe noire et des yeux à l’intensité profonde. Ils portaient des vestes noires épaisses et des bottes. Les deux hommes flanqués de chaque côté de la porte étaient grands et maigres. Derrière eux, le troisième était large d’épaules et massif, avec un air renfrogné qui semblait ne jamais le quitter.
“Reid Lawson,” prononça le grand homme de droite. “C’est bien vous ?” Son accent paraissait iranien, mais il était léger, suggérant que cela faisait déjà quelques temps qu’il était aux États-Unis.
Reid eut la gorge sèche en remarquant, par-dessus leurs épaules, une camionnette grise stationnée au bord du trottoir, phares éteints. “Hum, je suis navré,” leur dit-il. “Vous devez faire erreur.”
Sans quitter Reid des yeux, le grand homme de droite montra quelque chose à ses deux acolytes sur son téléphone mobile. L’homme de gauche, celui qui avait posé la question, acquiesça.
Tout à coup, l’homme massif fit un bond en avant étonnement rapide pour sa taille. Sa main charnue saisit Reid à la gorge. Reid pivota hors d’atteinte par pur réflexe, tituba en arrière et tomba presque à plat au sol. Il parvint à parer la chute de justesse, touchant le sol carrelé du bout des doigts.
Alors qu’il se redressait pour retrouver son équilibre, les trois hommes entrèrent dans la maison. Il paniqua en pensant à ses deux filles, endormies dans leurs lits, à l’étage.
Il se retourna et se mit à courir dans le couloir, déboulant dans la cuisine et contournant l’îlot central. En jetant un coup d’œil derrière lui, il vit les hommes à ses trousses. Téléphone portable, pensa-t-il, désespéré. Il était sur son bureau, à l’étage, et ses assaillants bloquaient le passage.
Il fallait qu’il les éloigne de la maison et de ses filles. À sa droite, se trouvait la porte qui donnait sur la cour. Il l’ouvrit et se remit à courir sur la passerelle. L’un des hommes l’insulta dans une langue étrangère, de l’arabe pensa-t-il, courant derrière lui. Reid sauta par-dessus la rampe de la passerelle et atterrit dans la petite cour. Une décharge douloureuse traversa sa cheville au moment où il toucha le sol, mais il l’ignora. Il contourna l’angle de la maison et s’aplatit contre la façade en brique, essayant désespérément de faire taire sa respiration haletante.