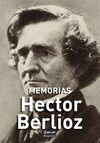Loe raamatut: «Mémoires de Hector Berlioz», lehekülg 45
Les artistes de Londres, indignés de cette vilenie, ont voulu m'exprimer leur sympathie en souscrivant, au nombre de deux cent trente, pour un Testimonial concert, qu'ils m'engageaient à donner avec leur concours gratuit dans la salle d'Exeter-hall, mais qui néanmoins n'a pu avoir lieu. L'éditeur Beale (aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis) m'a en outre apporté un présent de deux cents guinées qui m'était offert par une réunion d'amateurs, en tête desquels figuraient les célèbres facteurs de piano, MM. Broadwood. Je n'ai pas cru devoir accepter ce présent si en dehors de nos mœurs françaises, mais dont une bonté et une générosité réelles avaient néanmoins suggéré l'idée. Tout le monde n'est pas Paganini.
Ces preuves d'affection m'ont touché beaucoup plus que ne m'avaient blessé les insultes des cabaleurs.
En Allemagne, sans doute, je n'aurais rien de pareil à redouter. Mais je ne sais pas l'allemand; il faudrait composer sur un texte français qu'on traduirait ensuite; c'est un grand désavantage. Il faudrait aussi, pour écrire un grand opéra, y consacrer au moins dix-huit mois sans m'occuper d'autre chose, sans rien gagner par conséquent, et sans dédommagement possible sous ce rapport, puisque, en Allemagne, les compositeurs d'opéras ne touchent pas d'honoraires. Encore a-t-on vu dans mon récit de la première exécution de Faust en Prusse, ce qu'une inoffensive observation imprimée dans le Journal des Débats m'avait attiré d'inimitiés parmi les musiciens de l'orchestre de Berlin.
À Leipzig aussi, bien qu'on entende aujourd'hui ma musique avec d'autres oreilles qu'au temps de Mendelssohn (à ce que j'ai pu voir, et à ce que m'assure Ferdinand David) il y a encore quelques petits fanatiques, élèves du Conservatoire, qui, me regardant, sans savoir pourquoi, comme un destructeur, un Attila de l'art musical, m'honorent d'une haine forcenée, m'écrivent des injures et me font des grimaces dans les corridors de Gewandhaus quand j'ai le dos tourné. Puis certains maîtres de chapelle, dont je trouble la quiétude, commettent par ci par là à mon égard, d'assez plates perfidies. Mais cet inévitable antagonisme, joint même à l'opposition toute naturelle d'une petite partie de la presse allemande126, n'est rien en comparaison des fureurs qui se donneraient carrière à Paris contre moi si je m'y exposais au théâtre.
Depuis trois ans, je suis tourmenté par l'idée d'un vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique, ainsi que je viens de le faire pour ma trilogie sacrée: l'Enfance du Christ. Je résiste à la tentation de réaliser ce projet et j'y résisterai, je l'espère, jusqu'à la fin127. Le sujet me paraît grandiose, magnifique et profondément émouvant, ce qui prouve jusqu'à l'évidence que les Parisiens le trouveraient fade et ennuyeux. Me trompai-je même en attribuant à notre public un goût si différent du mien (pour parler comme le grand Corneille), je n'aurais pas une femme intelligente et dévouée capable d'interpréter le rôle principal, un rôle qui exige de la beauté, une grande voix, un talent dramatique réel, une musicienne parfaite, une âme et un cœur de feu. J'aurais bien moins encore entre les mains le reste des ressources de toute espèce dont je devrais pouvoir disposer à mon gré, sans contrôle ni observations de qui que ce fût. L'idée seule d'éprouver pour l'exécution et la mise en scène d'une œuvre pareille les obstacles stupides que j'ai dû subir et que je vois journellement opposer aux autres compositeurs qui écrivent pour notre grand opéra, me fait bouillir le sang. Le choc de ma volonté contre celle des malveillants et des imbéciles en pareil cas, serait aujourd'hui excessivement dangereux, je me sens parfaitement capable de tout à leur égard, et je tuerais ces gens-là comme des chiens. Quant à grossir le nombre des œuvres agréables et utiles qu'on nomme opéras-comiques et qui se produisent journellement à Paris, par fournées, comme on y produit des petits pâtés, je n'en éprouve pas la moindre envie. Je ne ressemble point, sous ce rapport, à ce caporal qui avait l'ambition d'être domestique. J'aime mieux rester simple soldat128. L'influence de Meyerbeer, je dois le dire aussi, et la pression qu'il exerce par son immense fortune, au moins autant que par les réalités de son talent éclectique, sur les directeurs, sur les artistes, sur les critiques, et par suite sur le public de Paris, y rendent à peu près impossible tout succès sérieux à l'Opéra. Cette influence délétère se fera sentir encore peut-être dix ans après sa mort. Henri Heine prétend qu'il a payé d'avance…129 Quant aux concerts musicaux que je pourrais donner à Paris, j'ai déjà dit dans quelles conditions je me trouvais placé et quelle était devenue l'indifférence du public pour tout ce qui n'est pas le théâtre. La coterie du Conservatoire a d'ailleurs trouvé le moyen de me faire interdire l'accès de sa salle, et M. le ministre de l'intérieur est un jour venu, à une distribution de prix, déclarer à tout l'auditoire que cette salle (la seule convenable qui existe à Paris) était la propriété exclusive de la Société du Conservatoire et qu'elle ne serait plus désormais prêtée à personne pour y donner des concerts. Or, personne, c'était moi; car, à deux ou trois exceptions près, aucun autre que moi n'y avait donné de grandes exécutions musicales depuis vingt ans.
Cette société célèbre, dont presque tous les membres exécutants sont de mes amis ou partisans, est dirigée par un chef et par un petit nombre de faiseurs qui me sont hostiles. Ils se garderaient donc bien d'admettre dans leurs concerts la moindre de mes compositions. Une seule fois, il y a six ou sept ans, ils s'avisèrent de me demander deux fragments de Faust. Le comité qui avait été alors tant soit peu influencé par l'opinion de mes partisans de l'orchestre, essaya en revanche de m'écraser en me plaçant, dans le programme, entre le finale de la Vestale, de Spontini, et la Symphonie en ut mineur, de Beethoven. Le bonheur voulut que l'écrasement n'eût pas lieu et que ces messieurs fussent déçus dans leur attente. Malgré les terribles voisins qu'on lui avait donnés, la scène des Sylphes de Faust excita un véritable enthousiasme et fut bissée. Mais M. Girard, qui en avait fort maladroitement et fort platement dirigé l'exécution, feignit de ne pas pouvoir trouver dans la partition l'endroit où il fallait recommencer, et, malgré les cris de bis de toute la salle, il ne recommença pas. Le succès n'en fut pas moins évident. Aussi, depuis cette époque, la coterie s'est-elle abstenue de mes ouvrages comme de la peste.
Des millionnaires, qui abondent à Paris, pas un seul n'aurait l'idée de rien faire pour la grande musique. Nous ne possédons pas une bonne salle de concerts publique; il ne viendrait en tête à aucun de nos Crésus d'en construire une. L'exemple de Paganini a été perdu, et ce que ce noble artiste fit pour moi restera un trait unique dans l'histoire.
Il faut donc compter seulement sur soi-même quand on est compositeur à Paris, produisant des œuvres sérieuses en dehors du théâtre. Il faut se résigner à des exécutions incomplètes, incertaines, et par suite plus ou moins infidèles, faute de répétitions qu'on ne peut payer130, à des salles incommodes où les exécutants ni l'auditoire ne peuvent être bien installés, à des entraves de toute espèce suscitées, sans mauvais vouloir, par les théâtres lyriques dont on est obligé d'employer le personnel musical et qui ont nécessairement à veiller aux intérêts de leur répertoire; il faut subir des spoliations insolentes de la part de MM. les percepteurs du droit des hospices, qui ne tiennent aucun compte des frais d'un concert, et viennent aggraver les pertes de celui qui le donne, en prélevant le huitième de la recette brute; des appréciations hâtives et nécessairement fausses d'œuvres vastes et complexes entendues dans de pareilles conditions, et rarement plus d'une ou deux fois; et, en dernière analyse, il faut avoir à dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Sans compter la force d'âme et de volonté qu'on a l'humiliation d'user contre de pareils obstacles. L'artiste le plus puissamment doué de ces qualités, est alors comme un obus chargé qui va droit son chemin, renverse tout ce qu'il rencontre, laisse une trace, il est vrai, mais ne doit pas moins, au terme de sa course, se briser en éclatant. Je ferais pourtant en général, tous les sacrifices possibles. Mais il est des circonstances où cessant d'être généreux, ces sacrifices deviennent éminemment coupables.
Il y a deux ans, au moment où l'état de la santé de ma femme, qui laissait encore alors quelque espoir d'amélioration, m'occasionnait le plus de dépenses, une nuit, j'entendis en songe une symphonie que je rêvais composer. En m'éveillant le lendemain je me rappelai presque tout le premier morceau qui (c'est la seule chose dont je me souvienne) était à deux temps (allegro), en la mineur. Je m'approchais de ma table pour commencer à l'écrire, quand je fis soudain cette réflexion: si j'écris ce morceau, je me laisserai entraîner à composer le reste. L'expansion à laquelle ma pensée tend toujours à se livrer maintenant, peut donner à cette symphonie d'énormes proportions. J'emploierai peut-être trois ou quatre mois exclusivement à ce travail. (J'en ai bien mis sept pour écrire Roméo et Juliette.) Je ne ferai plus ou presque plus de feuilletons. Mon revenu diminuera d'autant. Puis, quand la symphonie sera terminée, j'aurai la faiblesse de céder aux sollicitations de mon copiste; je la laisserai copier, je contracterai ainsi tout de suite une dette de mille ou douze cents francs. Une fois les parties copiées, je serai harcelé par la tentation de faire entendre l'ouvrage, je donnerai un concert, dont la recette couvrira à peine la moitié des frais; c'est inévitable aujourd'hui. Je perdrai ce que je n'ai pas; je manquerai du nécessaire pour la pauvre malade, et je n'aurai plus ni de quoi faire face à mes dépenses personnelles ni de quoi payer la pension de mon fils sur le vaisseau où il doit monter prochainement. Ces idées me donnèrent le frisson et je jetai ma plume en disant: Bah! demain j'aurai oublié la symphonie! La nuit suivante, l'obstinée symphonie vint se présenter encore et retentir dans mon cerveau; j'entendais clairement l'allégro en la mineur, bien plus, il me semblait le voir écrit. Je me réveillai plein d'une agitation fiévreuse, je me chantai le thème, dont le caractère et la forme me plaisaient extrêmement; j'allais me lever… mais les réflexions de la veille me retinrent encore, je me raidis contre la tentation, je me cramponnai à l'espoir d'oublier. Enfin, je me rendormis, et le lendemain, au réveil, tout souvenir en effet, avait disparu pour jamais.
Lâche! va dire quelque jeune fanatique à qui je pardonne d'avance son injure, il fallait oser! il fallait écrire! il fallait te ruiner! On n'a pas le droit de chasser ainsi la pensée, de faire rentrer dans le néant une œuvre d'art qui en veut sortir et qui implore la vie! Ah! jeune homme qui me traites de lâche, tu n'as pas subi le spectacle que j'avais alors sous les yeux, sans quoi tu serais moins sévère. Je n'ai pas reculé aux jours où l'on pouvait encore douter des conséquences de mes coups d'audace. Il y avait dans ce temps à Paris un petit public d'élite, il y avait les princes de la maison d'Orléans et la Reine elle-même qui s'y intéressaient. Ma femme d'ailleurs était toute vivante et la première à m'encourager: «Tu dois produire cette œuvre, me disait-elle, et la faire grandement et dignement exécuter. Ne crains rien, nous subirons les privations que ces dépenses nous imposeront. Il le faut! va toujours!» Et j'allais. Mais plus tard, quand elle était là, à demi morte, ne pouvant plus que gémir, quand il lui fallait trois femmes pour la soigner, quand le médecin devait lui faire presque chaque jour une visite, quand j'étais sûr, mais sûr comme il l'est que les Parisiens sont des barbares, de trouver au bout de toute entreprise musicale le désastreux résultat que je viens de signaler, je n'étais pas lâche de m'abstenir, jeune homme, non, j'ai la conscience d'avoir été seulement humain; et, tout en me croyant aussi dévoué à l'art que toi, et que bien d'autres, je crois l'honorer en ne le traitant pas de monstre avide de victimes humaines et en prouvant qu'il m'a laissé assez de raison pour distinguer le courage de la férocité. Si j'ai cédé peu à peu à l'entraînement musical, en écrivant dernièrement ma trilogie sacrée (l'Enfance du Christ), c'est que ma position n'est plus la même, d'aussi impérieux devoirs ne me sont plus imposés. D'ailleurs j'ai la certitude de faire aisément et souvent exécuter cet ouvrage en Allemagne où je suis invité à revenir par plusieurs villes importantes. J'y vais maintenant fréquemment, j'y ai fait quatre voyages pendant les derniers dix-huit mois131. On m'y accueille de mieux en mieux; les artistes m'y témoignent une sympathie de jour en jour plus vive; ceux de Leipzig, de Dresde, de Hanovre, de Brunswick, de Weimar, de Carlsruhe, de Francfort, m'ont comblé de marques d'amitié pour lesquelles je manque d'expressions de reconnaissance. Je n'ai qu'à me louer du public aussi, des intendants des théâtres royaux et des chapelles ducales, et de la plupart des princes souverains. Ce charmant jeune roi de Hanovre et son Antigone132 la reine, s'intéressent à ma musique au point de venir à huit heures du matin à mes répétitions et d'y rester jusqu'à midi quelquefois, pour mieux pénétrer, me disait le roi dernièrement, le sens intime des œuvres et se familiariser avec la nouveauté des procédés! Avec quelle joie, quels mouvements d'enthousiasme, il m'entretenait de mon ouverture du Roi Lear:
«C'est magnifique, monsieur Berlioz, c'est magnifique! votre orchestre parle, vous n'avez pas besoin de paroles. J'ai suivi toutes les scènes: l'entrée du roi dans son conseil, et l'orage sur la bruyère, et l'affreuse scène de la prison, et les plaintes de Cordelia133! Oh! cette Cordelia! comme vous l'avez peinte! comme elle est timide et tendre! c'est déchirant, et si beau!»
La reine, à ma dernière visite à Hanovre, me fit prier de mettre dans mon programme, deux morceaux de Roméo et Juliette, dont l'un surtout, lui est particulièrement cher, la scène d'amour (l'adagio). Le roi m'a ensuite formellement demandé de revenir l'hiver prochain pour organiser au théâtre l'exécution de l'œuvre entière de Roméo et Juliette, dont je n'ai donné encore à Hanovre que des fragments. «Si vous ne trouvez pas suffisantes les ressources dont nous disposons, a-t-il ajouté, je ferai venir des artistes de Brunswick, de Hambourg, de Dresde même, s'il le faut, vous serez content.» De son côté le nouveau grand-duc de Weimar m'a dit en me quittant, à la dernière visite que je lui ai faite: «Donnez-moi votre main, monsieur Berlioz, que je la serre avec une sincère et vive admiration; et n'oubliez pas que le théâtre de Weimar vous est toujours ouvert.» M. de Lüttichau, l'intendant du roi de Saxe, m'a proposé la place de maître de chapelle de Dresde, qui ne tardera pas à être vacante. «Si vous vouliez (ce sont ses paroles), que de belles choses nous ferions ici! avec nos artistes que vous trouvez si excellents, et qui vous aiment tant, vous qui dirigez comme si peu de gens dirigent, vous feriez de Dresde le centre musical de l'Allemagne!» Je ne sais si je me déciderai à me fixer ainsi en Saxe quand le moment sera venu… C'est à bien examiner. Liszt est d'avis que je dois accepter. Mes amis de Paris sont d'un avis contraire. Mon parti n'est pas pris, et la place d'ailleurs est encore occupée. Il est question de mettre en scène, à Dresde, mon opéra de Cellini, que cet admirable Liszt a déjà ressuscité à Weimar.
Certainement alors j'irais en diriger les premières représentations. Au reste, je n'ai pas à m'occuper ici de l'avenir et me suis peut-être trop appesanti sur le passé, bien que j'aie laissé dans l'ombre beaucoup de curieux épisodes et de tristes détails. Je finis… en remerciant avec effusion la sainte Allemagne où le culte de l'art s'est conservé pur; et toi, généreuse Angleterre; et toi, Russie qui m'as sauvé; et vous, mes bons amis de France: et vous, cœurs et esprits élevés de toutes les nations que j'ai connus. Ce fut pour moi un bonheur de vous connaître: je garde et je garderai fidèlement de nos relations le plus cher souvenir. Quant à vous, maniaques, dogues et taureaux stupides, quant à vous mes Guildenstern, mes Rosencranz134, mes Jago, mes petits Osrick135, serpents et insectes de toute espèce, farewell my… friends136; je vous méprise, et j'espère bien ne pas mourir sans vous avoir oubliés.
Paris, 18 octobre 1854.
POST-SCRIPTUM
Lettre adressée avec le manuscrit de mes mémoires à M.*** qui me demandait des notes pour écrire ma biographie 137
Monsieur,
Vous désirez connaître les causes de l'opposition que j'ai rencontrée à Paris comme compositeur pendant vingt-cinq ans. Ces causes furent nombreuses; fort heureusement elles ont en partie disparu138. La bienveillance de toute la presse (en exceptant la Revue des Deux-Mondes, dont la critique musicale est confiée à un monomane, et dont le directeur m'honore de sa haine) à l'occasion de mon dernier ouvrage l'Enfance du Christ, semble le prouver. Plusieurs personnes ont cru voir dans cette partition un changement complet de mon style et de ma manière. Rien n'est moins fondé que cette opinion. Le sujet a amené naturellement une musique naïve et douce, et par cela même plus en rapport avec leur goût et leur intelligence, qui, avec le temps, avaient dû en outre se développer. J'eusse écrit l'Enfance du Christ de la même façon il y a vingt ans.
La principale raison de la longue guerre qu'on m'a faite est dans l'antagonisme existant entre mon sentiment musical et celui du gros public parisien. Une foule de gens ont dû me regarder comme un fou, puisque je les regarde comme des enfants ou des niais. Toute musique qui s'écarte du petit sentier où trottinent les faiseurs d'opéras-comiques fut nécessairement, pendant un quart de siècle, de la musique de fou pour ces gens-là. Le chef-d'œuvre de Beethoven (la neuvième symphonie) et ses colossales sonates de piano, sont encore pour eux de la musique de fou.
Ensuite j'ai eu contre moi les professeurs du Conservatoire ameutés par Cherubini et par Fétis, dont mon hétérodoxie en matière de théories harmoniques et rhythmiques avait violemment froissé l'amour-propre et révolté la foi. Je suis un incrédule en musique, ou, pour mieux dire, je suis de la religion de Beethoven, de Weber, de Gluck, de Spontini, qui croient, professent et prouvent par leurs œuvres que tout est bon ou que tout est mauvais; l'effet produit par certaines combinaisons devant seul les faire condamner ou absoudre.
Maintenant les professeurs même les plus obstinés à soutenir l'autorité des vieilles règles s'en affranchissent plus ou moins dans leurs œuvres.
Il faut compter encore parmi mes adversaires les partisans de l'école sensualiste italienne, dont j'ai souvent attaqué les doctrines et blasphémé les dieux.
Aujourd'hui je suis plus prudent. J'abhorre toujours, comme je les abhorrais autrefois, ces opéras proclamés par la foule des chefs-d'œuvre de musique dramatique, mais qui sont pour moi d'infâmes caricatures du sentiment et de la passion; seulement j'ai la force de n'en plus parler.
Toutefois ma position de critique continue à me faire de nombreux ennemis. Et les plus ardents dans leur haine sont moins encore ceux dont j'ai blâmé les œuvres, que ceux dont je n'ai pas parlé ou que j'ai mal loués. D'autres ne me pardonneront jamais certaines plaisanteries. J'eus l'imprudence, il y a dix-huit ou vingt ans, de faire la suivante à propos d'un très-plat petit ouvrage de Rossini. Ce sont trois cantiques intitulés: la Foi, l'Espérance et la Charité. Après les avoir entendus, j'écrivis je ne sais où, en parlant de l'auteur: Son Espérance a déçu la nôtre, sa Foi ne transportera pas des montagnes, et quant à la Charité qu'il nous a faite elle ne le ruinera pas.
Vous jugez de la fureur des rossinistes; bien que j'eusse écrit ailleurs une longue analyse admirative de Guillaume Tell, et répété à satiété que le Barbier est un des chefs-d'œuvre du siècle.
M. Panseron m'ayant envoyé un prospectus ridicule où il annonçait, en français de portière, l'ouverture d'un cabinet de consultations musicales, où les amateurs auteurs de romances pouvaient aller faire corriger leurs productions pour la somme de cent francs, je publiai la chose dans le Journal des Débats; j'insérai même en entier le prospectus de M. Panseron, mais sous ce titre:
Cabinet de consultations pour les mélodies secrètes
Quelques années auparavant M. Caraffa, avait fait représenter un opéra intitulé la Grande-Duchesse. Cet ouvrage n'eut que deux représentations. Après la deuxième, ayant à en rendre compte, je me bornai à citer les paroles célèbres de Bossuet dans son oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre: Madame se meurt, Madame est morte! M. Caraffa ne m'a pas pardonné. Il faut avouer que je lâchais aussi parfois dans la conversation des paroles qu'on pouvait prendre pour de véritables coups de poignard. Un soir, j'étais chez mon ami d'Ortigue avec quelques personnes, parmi lesquelles se trouvaient M. de Lamennais et un sous-chef du ministère de l'intérieur. La conversation s'établit sur le mécontentement que chacun éprouve de la condition dans laquelle il est placé. M. P… le sous-chef, ne se trouvait pas mécontent de la sienne: «J'aime mieux, dit-il, être ce que je suis que toute autre chose. – Ma foi, répliquai-je étourdiment, je ne suis pas comme vous, et j'aimerais mieux être toute autre chose que ce que vous êtes.»
Mon interlocuteur eut la force de ne rien répondre, mais je suis bien sûr que nos éclats de rire et ceux de M. de Lamennais surtout lui sont restés sur le cœur.
J'ai, depuis quelques années, de nouveaux ennemis dus à la supériorité qu'on veut bien m'accorder dans l'art de diriger les orchestres. Les musiciens, par le talent exceptionnel qu'ils déploient sous ma direction, par leurs démonstrations chaleureuses et par les paroles qu'ils laissent échapper, m'ont rendu hostiles en Allemagne presque tous les chefs d'orchestre. Il en fut longtemps ainsi à Paris. Vous verrez dans mes Mémoires les étranges effets du mécontentement d'Habeneck et de M. Girard. Il en est de même à Londres, où M. Costa me fait une guerre sourde partout où il a le pied.
J'ai dû combattre une belle phalange, vous en conviendrez. N'oublions pas les chanteurs et les virtuoses, que je rappelle a l'ordre d'une assez rude façon, quand ils se permettent d'irrévérencieuses libertés en interprétant les chefs-d'œuvre; ni les envieux, toujours prêts à se courroucer si quelque chose se manifeste avec un certain éclat.
Mais cette vie de combat, l'opposition se trouvant réduite, comme elle l'est aujourd'hui, à des proportions raisonnables, offre un certain charme. J'aime à faire de temps en temps craquer une barrière, en la brisant au lieu de la franchir. C'est l'effet naturel de ma passion pour la musique, passion toujours incandescente et qui n'est jamais satisfaite qu'un instant. L'amour de l'argent ne s'est en aucune circonstance allié à cet amour de l'art; j'ai toujours, au contraire, été prêt à faire toute espèce de sacrifices pour courir à la recherche du beau ou me garantir du contact des mesquines platitudes couronnées par la popularité. On m'offrirait cent mille francs pour certaines œuvres dont le succès est immense, que je refuserais avec colère. Je suis ainsi fait. Il vous sera aisé de tirer les conséquences d'une semblable organisation placée dans un milieu tel qu'était, il y a vingt ans, le monde musical de Paris.
S'il fallait maintenant ici esquisser la contre-partie du tableau, je le pourrais, en prenant mon parti de manquer carrément de modestie. Les sympathies que j'ai rencontrées en France, en Angleterre, en Allemagne et en Russie m'ont consolé de bien des peines. Je pourrais même citer des manifestations d'enthousiasme fort singulières. Ai-je besoin d'attirer votre attention sur l'épisode du royal présent de Paganini et sur la lettre si cordialement artiste qu'il y joignit?..
Je me bornerai à vous faire connaître un joli mot de Lipinski, le concert-meister du théâtre de Dresde. Je me trouvais, il y a trois ans, dans cette capitale de la Saxe. Après un splendide concert où l'on venait d'exécuter ma légende de la Damnation de Faust, Lipinski me présenta un musicien désireux, disait-il, de me complimenter, mais qui ne savait pas un mot de français. Or, comme je ne sais pas l'allemand, lui, Lipinski, s'offrait pour servir d'interprète, quand l'artiste l'interrompant, s'avance vivement, me prend la main, balbutie quelques mots et éclate en sanglots qu'il ne pouvait plus contenir. Alors Lipinski, se tournant vers moi et me montrant les larmes de son ami: «Vous comprenez!» me dit-il…
Et cet autre encore, un mot antique. À Brunswick, dernièrement, on allait, dans un concert au théâtre, exécuter plusieurs parties de ma symphonie avec chœurs de Roméo et Juliette. Le matin du jour de ce concert, un inconnu139 assis à côté de moi à la table d'hôte m'apprit qu'il avait fait un long voyage pour venir entendre à Brunswick cette partition.
« – Vous devriez écrire un opéra sur ce sujet, me dit-il, à la manière dont vous l'avez traité en symphonie et dont vous comprenez Shakespeare, vous feriez quelque chose d'inouï, de merveilleux.
– Hélas, monsieur, lui répondis-je, où sont les deux artistes capables de chanter et de jouer les deux rôles principaux? ils n'existent pas; et, existassent-ils, grâce aux mœurs musicales et aux usages qui règnent à cette heure dans tous les théâtres lyriques, si je mettais à l'étude un pareil opéra je serais sûr de mourir avant la première représentation.»
Le soir, mon amateur va au concert, et, dans un entr'acte, causant avec un de ses voisins, lui répète ma réponse du matin à propos d'un opéra de Roméo et Juliette. Le voisin garde un instant le silence, puis frappant violemment le rebord de sa loge, s'écrie: «Eh bien, qu'il meure! mais qu'il le fasse!»
Recevez, monsieur, l'assurance de ma vive gratitude pour la bienveillance que vous me témoignez et pour votre désir de me venger (selon votre expression) de tant de gens et de tant de choses injustes. Je crois qu'en fait de vengeance, il faut laisser faire le temps. C'est le grand vengeur; les gens et les choses dont j'eus et j'ai encore à me plaindre, ne sont pas d'ailleurs dignes de votre colère.
Je m'aperçois que je n'ai rien dit de technique sur ma manière d'écrire, et peut-être désirez-vous quelques détails à ce sujet.
En général mon style est très-hardi, mais il n'a pas la moindre tendance à détruire quoi que ce soit des éléments constitutifs de l'art. Au contraire, je cherche à accroître le nombre de ces éléments. Je n'ai jamais songé, ainsi qu'on l'a si follement prétendu en France, à faire de la musique sans mélodie. Cette école existe maintenant en Allemagne et je l'ai en horreur. Il est aisé de se convaincre que, sans même me borner à prendre une mélodie très-courte pour thème d'un morceau, comme l'ont fait souvent les plus grands maîtres, j'ai toujours soin de mettre un vrai luxe mélodique dans mes compositions. On peut parfaitement contester la valeur de ces mélodies, leur distinction, leur nouveauté, leur charme, ce n'est pas à moi qu'il appartient de les apprécier; mais nier leur existence, c'est, je le soutiens, mauvaise foi ou ineptie. Seulement ces mélodies étant souvent de très-grande dimension, les esprits enfantins, à courte vue, n'en distinguent pas la forme clairement; ou mariées à d'autres mélodies secondaires qui, pour ces mêmes esprits enfantins, en voilent les contours; ou enfin ces mélodies sont si dissemblables des petites drôleries appelées mélodies par le bas peuple musical, qu'il ne peut se résoudre à donner le même nom aux unes et aux autres.
Les qualités dominantes de ma musique sont l'expression passionnée, l'ardeur intérieure, l'entraînement rhythmique et l'imprévu. Quand je dis expression passionnée, cela signifie expression acharnée à reproduire le sens intime de son sujet, alors même que le sujet est le contraire de sa passion et qu'il s'agit d'exprimer des sentiments doux, tendres, ou le calme le plus profond. C'est ce genre d'expression qu'on a cru trouver dans l'Enfance du Christ, et surtout dans la scène du Ciel de la Damnation de Faust et dans le Sanctus du Requiem.
À propos de ce dernier ouvrage, il est bon de vous signaler un ordre d'idées dans lequel je suis à peu près le seul des compositeurs modernes qui soit entré, et dont les anciens n'ont pas même entrevu la portée. Je veux parler de ces compositions énormes désignées par certains critiques sous le nom de musique architecturale, ou monumentale, et qui a fait le poëte allemand Henri Heine m'appeler un rossignol colossal, une alouette de grandeur d'aigle, comme il en a existé, dit-on, dans le monde primitif. «Oui, continue le poëte, la musique de Berlioz, en général, a pour moi quelque chose de primitif, sinon d'antédiluvien, elle me fait songer à de gigantesques espèces de bêtes éteintes, à des mammouths, à de fabuleux empires aux péchés fabuleux, à bien des impossibilités entassées; ces accents magiques nous rappellent Babylone, les jardins suspendus de Sémiramis, les merveilles de Ninive, les audacieux édifices de Mizraim, tels que nous en voyons sur les tableaux de l'Anglais Martin.»
Dans le même paragraphe de son livre (Lutèce), H. Heine, continuant à me comparer à l'excentrique Anglais, affirme que j'ai peu de mélodie et que je n'ai point de naïveté du tout. Trois semaines après la publication de Lutèce eut lieu la première exécution de l'Enfance du Christ; et le lendemain je reçus une lettre de Heine où il se confondait en expressions de regrets de m'avoir ainsi mal jugé. «Il me revient de toutes parts, m'écrivait-il de son lit de douleurs, que vous venez de cueillir une gerbe des fleurs mélodiques les plus suaves, et que dans son ensemble votre oratorio est un chef-d'œuvre de naïveté. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir été ainsi injuste envers un ami.» J'allai le voir, et comme il recommençait ses récriminations contre lui-même: «Mais aussi, lui dis-je, pourquoi vous être laissé aller, comme un critique vulgaire, à exprimer une opinion absolue sur un artiste dont l'œuvre entière est si loin de vous être connue? Vous pensez toujours au Sabbat, à la Marche au supplice de ma Symphonie fantastique, au Dies iræ et au Lacrymosa de mon Requiem. Je crois pourtant avoir fait et pouvoir faire des choses d'un tout autre caractère.»…