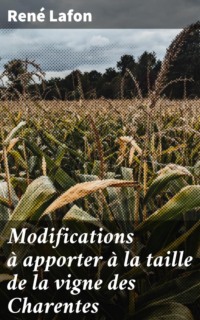Loe raamatut: «Modifications à apporter à la taille de la vigne des Charentes»
L'apoplexie, traitement préventif (méthode Poussard) , traitement curatif

Publié par Good Press, 2022
goodpress@okpublishing.info
EAN 4064066334819
INTRODUCTION
Dans les Charentes, dès le début de la reconstitution du vignoble, les systèmes de taille Guyot simple ou double furent employés de préférence aux systèmes de taille courte, parce que, tout en étant faciles et rapides à exécuter, ils permettaient d’obtenir une production élevée et régulière.
Nous avions donné la préférence à la taille Guyot simple, et fréquemment recommandé son emploi pour tous les cépages blancs de notre région.
L’objet de cette brochure est d’indiquer les raisons pour lesquelles notre opinion s’est modifiée, et pourquoi nous sommes amené à préconiser l’emploi d’une taille nouvelle, que nous appellerons taille Guyot-Poussard. Et après les avoir exposées, nous décrirons, avec le plus de clarté possible, cette méthode de taille; nous compléterons enfin cette étude par des observations sur l’apoplexie de la vigne et l’indication du traitement préventif et du traitement curatif formulé à la suite de longues et patientes recherches par M. Poussard. Nous y ajouterons quelques considérations personnelles.
Jusqu’à ces derniers temps, on s’accordait à penser que les vignobles ayant produit d’abondantes récoltes pendant une période de vingt à vingt-cinq années (à l’exception de ceux situés dans des sols frais, profonds et riches), devenaient trop onéreux à cultiver pour mériter de continuer à l’être.
En effet, leur production, quoique les frais de culture restent les mêmes – la superficie du vignoble n’ayant pas varié – se trouvait réduite non seulement à cause des pieds de vignes manquants, mais aussi à cause des pieds affaiblis, le nombre des uns et des autres augmentant d’ailleurs chaque année. Il fallait donc se résoudre, après ce laps de temps, à arracher les vieilles souches encore existantes pour replanter le vignoble.
Les capitaux importants exigés par des plantations nouvelles, le manque à gagner résultant des trois ou quatre années qui s’écoulent avant leur production, ont amené un certain nombre de viticulteurs à essayer d’enrayer ou d’éviter l’abaissement des rendements dans les vignobles âgés, en remplaçant les pieds manquants, les uns par des producteurs directs, les autres par des provins. Mais les producteurs directs furent très peu employés, en raison des difficultés d’adaptation au sol, de l’insuffisance de leur résistance phylloxérique dans la plupart des terrains, et du manque de qualité du vin ou des eaux-de-vie qu’ils produisaient. Les provins furent plus souvent utilisés.
Le remplacement des manquants par ce que les vignerons Charentais appellent un «provin» et les jardiniers une «marcotte», puis le provignage de tous les ceps vigoureux furent pratiqués, pour la première fois depuis la reconstitution, par M. A. Verneuil, dans des pièces de vignes dont il avait décidé l’arrachage, afin de leur faire produire le maximum possible de récolte avant leur disparition. Nous continuons à penser que ce procédé est très avantageux à employer dans les vignes dont l’arrachage est décidé en raison du nombre de manquants, de l’utilité de changer le greffon ou d’apporter une modification dans les écartements des rangs et des ceps, etc. etc., et souvent pour plusieurs de ces raisons à la fois.
Mais, provigner une pièce de vigne dont la production baisse, ne permet de la conserver que durant le nombre d’années pendant lequel les suppléments de récolte, dus aux provins, font que le rendement de l’ensemble de la pièce demeure rémunérateur. Aussi, fallut-il chercher mieux; c’est alors que quelques viticulteurs s’étant’ rendu compte que le dépérissement des vieux vignobles était imputable à la taille, qui provoque des plaies plus ou moins considérables et que la taille Guyot simple ou double occasionnant de nombreuses coupes hâtait la disparition précoce des ceps, s’efforcèrent à conserver la vigueur des pieds de vigne, à maintenir leur vitalité et à prolonger leur durée, en un mot à remédier aux causes de dépérissement par une modification des systèmes de taille usités ou même par l’emploi d’une taille nouvelle. – On avait en effet remarqué :
1° Que dans les plantations âgées de 20 à 25 ans et plus, ayant beaucoup de pieds faibles et de manquants, un certain nombre de ceps se maintenaient avec une vigueur et une fructification très satisfaisantes;
2° Qu’à l’emplacement des ceps manquants, le porte-greffe, lorsqu’il n’avait pas été arraché, continuait à se développer normalement, émettant des rejets très abondants utilisables comme bois à greffer;
3° Que les ceps en voie de dépérissement progressif émettaient, les uns de nombreux gourmands au voisinage de la soudure, les autres des rejets au porte-greffe.
De ces observations, on pouvait avec raison conclure que le système radiculaire et une partie du porte-greffe restant sains et vigoureux, la disparition du greffon français ne pouvait résulter que des mutilations de la taille opérée sur les bras ou le tronc du cep. Il en résultait que le système de taille devait être changé ou amélioré afin d’éviter ou de réduire au minimum possible lesmutilations qni provoquent le dessèchement et la mortification des tissus intérieurs ou extérieurs, détériorant plus ou moins complètement les conduits de la sève.
Cette détérioration progressive des tissus où circule la sève est le plus souvent aggravée par la présence du champignon de l’apoplexie, qui en se développant dans les tissus desséchés et ceux en voie de dessiccation, ainsi que nous le verrons plus loin, finit par interrompre complètement la circulation de la sève et par occasionner ainsi la mort soudaine d’une partie du cep ou même du cep entier (apoplexie).
Parmi les viticulteurs qui avaient fait ces constatations, M. E. Poussard, spécialiste de la taille à Pérignac (Charente-Inférieure), est le premier dans notre région qui en ait tiré les véritables conclusions pratiques.
C’est en effet à un modeste vigneron qui, très jeune, commença à apprendre la taille dans le Pays-Bas, puis vint ensuite, comme journalier, sous la direction de MM. Mériot, régisseur, et Sauvignon, chef dé culture, du domaine d’Ars, appartenant alors à M. Emmanuel Castaigne, c’est à ses patientes recherches, à son esprit d’observation, à son intelligente obstination, à ses expériences nombreuses et persévérantes que nous devons de pouvoir présenter notre nouvelle étude sur la taille et l’apoplexie. Il nous plait de le reconnaître et de lui en faire revenir le mérite.
Les résultats des recherches de M. Poussard peuvent être ramenés aux trois point suivants:
1° Efficacité du «curetage» contre l’apoplexie permettant de guérir les ceps partiellement apoplexiés, à la condition qu’une partie du greffon reste saine au-dessus de la soudure, que le sujet soit sain ou partiellement atteint;
2° Un remède préventif contre l’apoplexie;
3° Un système de taille, qui, par son mode d’établissement, évite les plaies sur le tronc du cep et à la base des bras, et qui, dans son exécution annuelle situe toujours les plaies du même côté des bras, assurant ainsi la circulation à peu près ininterrompue de la sève, sur tout le calibre du tronc et dans la plus grande partie des bras porteurs des bois de production (lattes et crochets).
Ce système de taille, en évitant les mutilations sur le tronc même du cep et en assurant la circulation de la sève dans de bonnes conditions, réduit autant que possible les cas de dépérissement et d’apoplexie. Il permet d’obtenir une végétation et une fructification qui se maintiennent meilleures pendant beaucoup plus longtemps qu’avec les systèmes de taille Guyot simple ou double, et ainsi prolonge considérablement la durée des vignes.
Ce système de taille appliqué aux vieilles vignes, augmente leur vigueur et leur fructification.
M. Poussard taille depuis 10 ans une pièce de Folle et Colombard sur Riparia, que le propriétaire avait entreplantée entre les ceps, pour l’arracher 3 ou 4 ans après en raison de son état de rabougrissement et de sa faible production.
Le système de taille Guyot-Poussard double appliqué à cette vigne (soumise jusqu’alors à la taille Guyot double), – sans autres modifications à la culture et à la fumure – en a augmenté la vigueur et la fructification de cinquante pour cent.
Telles sont les conclusions de M. Poussard. Nous les avons étudiées avec soin et nous sommes persuadé qu’elles sont fondées.
Nous allons nous efforcer, dans les chapitres suivants, d’exposer les réflexions qu’elles nous ont suggérées et les études auxquelles elles nous ont conduites, lorsqu’elles nous furent révélées.
René LAFON.
DÉPÉRISSEMENT PROGRESSIF ET «APOPLEXIE» DES VIGNES
Depuis une douzaine d’années et en particulier en 1918-1919-1920, trois années sèches, tous les viticulteurs charentais ont constaté de nombreux cas de dépérissement et d’ «apoplexie» dans presque tous les vignobles âgés de 20 à 30 ans, même dans les vignes soumises à une bonue culture et où la longueur de la taille a toujours été bien en rapport avec la vigueur.
Quelles sont les causes:
1° Du dépérissement progressif d’un grand nombre de ceps?
2° De l’apoplexie?
Nous répondrons tout de suite que ces affections sont dues «aux plaies de taille» .
Pour le montrer, nous allons comparer à des âges différents des vignes greffées, du même cépage (porte-greffe et greffon) et plantées dans un même sol, cultivées et fumées dans les mêmes conditions, mais conduites à des systèmes de taille différents.
Pour quelques systèmes de taille, en particulier, nous ferons dans la même pièce de vigne:
1° Des constatations sur la vigueur et la fructification des ceps, à des âges différents;
2° Un examen détaillé de l’extérieur et de l’intérieur des ceps.
Constatations sur la végétation et la fructification des vignes conduites:
1. – A la taille Guyot simple
Dans une pièce de vigne âgée de 6 à 8 ans, dont la plantation a été réussie avec très peu de manquants et qui a été maintenue en bon état de culture, nous constatons, qu’à 5 ou 10 0/0 près tous les ceps de la pièce ont une vigueur et une fructification sensiblement égales.
Les rendements obtenus dans cette pièce de vigne atteignent et dépassent même quelquefois quarante hectolitres au journal dans les bonnes années.
Si nous examinons à nouveau cette pièce de vigne lorsqu’elle a environ 15 ans, nous constatons des différences souvent très grandes entre la vigueur des ceps.
Sur cent ceps, cinquante environ sont vigoureux et bien fructifères, vingt-cinq ont une vigueur et une fructification moyennes, tandis que sur les vingt-cinq restants, un grand nombre est en voie de dépérissement très marqué et quelques-uns sont plus ou moins complètement rabougris.
Dans les bonnes années, le rendement a baissé d’un tiers et quelquefois de moitié. Entre quinze et vingt ans, un peu plus tôt, ou un peu plus tard, selon la façon dont les vignerons auront pratiqué les ravalements, un certain nombre de ceps meurent brusquement (apoplexie).
De plus, le pourcentage des pieds en voie de dépérissement augmente beaucoup, ce qui a pour conséquence un amoindrissement très sensible des récoltes.
Entre 20 et 30 ans, le nombre des pieds dépérissant et atteints d’apoplexie va en augmentant, si bien que le pourcentage des non-valeurs peut atteindre 20 à 25 0/0 et celui des manquants par «apoplexie » 15 à 25 0/0.
Les récoltes deviennent tellement faibles que dans la plupart des cas, le viticulteur a intérêt à procéder à l’arrachage des ceps restant. Il convient enfin de remarquer que dans les vignes placées dans les parties basses, où les gelées sont fréquentes, les pourcentages des cas de dépérissement et d’ «apoplexie» sont plus élevés en raison des ravalements fréquents que le tailleur est obligé de pratiquer sur les souches, pour utiliser les gourmands qui se développent après la gelée.
L’ «apoplexie» apparaît souvent dans ces vignes avant la quinzième année.
2. – A la taille Guyot double
Avec cette taille, le nombre de ceps en voie de dépérissement est sensiblement le même qu’avec la taille Guyot simple, mais les cas d’ «apoplexie» sont généralement très peu nombreux avant la vingtième année.
Dans ce système, les plaies de taille sont plus nombreuses que dans la taille Guyot simple, mais elles sont moins dangereuses pour la vitalité du cep tant qu’elles sont faites sur les bras du tronc, en raison de leur petit diamètre; toutefois, lorsque le tailleur procède au renouvellement des bras, en utilisant des gourmands placés sur le tronc, les plaies ont la même gravité et les mêmes conséquences que dans la taille Guyot simple.
Les cas d’ «apoplexie», assez rares jusqu’à la vingtième année, deviennent, entre 20 et 30 ans, presque aussi nombreux qu’avec la taille Guyot simple.
On constate souvent la mort complète du cep; quelquefois, cependant, un seul bras est atteint, l’autre continuant à se développer normalement.
Nous verrons dans quelles conditions l’apoplexie d’un bras peut entraîner l’apoplexie générale ou rester limitée à ce seul bras.
3. – A la taille en gobelet ou en éventail
Les vignes conduites en gobelet ou en éventail ont une végétation plus régulière, plus soutenue et vivent plus longtemps qu’avec les deux systèmes de taille précédents.
Les cas de dépérissement et d’apoplexie s’y observent rarement avant la vingtième ou la vingt-cinquième année et en tout petit nombre seulement.
Avec l’emploi de ces deux systèmes, les plaies de taille sont nombreuses, mais elles se cicatrisent assez bien en raison de leur faible diamètre, la sève étant répartie sur 4, 5 ou 6 bras.
Lorsque les gobelets sont maintenus avec de longs bras, les cas d’apoplexie sont très rares et ne se produisent que très tardivement.
Dans le «Pays-Bas», quelques viticulteurs ont conduit leurs vignes françaises à la taille en gobelet à très longs bras, en situant les plaies de taille toujours du même côté du bras.
Cette façon de tailler assurait une circulation ininterrompue de la sève. M. E. Cocuaud nous a montré de vieux ceps conduits à ce système de taille qui se sont maintenus vigoureux et très fructifères pendant plus de cent ans. Leur vigueur n’a faibli que sous les attaques du phylloxéra.
Ils sont plus nombreux lorsque le vigneron, pour permettre le palissage des sarments sur des fils de fer, maintient les bras courts par des ravalements fréquents.
La production des cépages de notre région (Colombar et St-Émilion) conduits à la taille en gobelet est toujours inférieure à celle obtenue avec les systèmes Guyot simple et double.
Mais, tandis qu’à partir de la vingt-cinquième année, la production baisse considérablement avec les tailles Guyot simple et double, les gobelets continuent à donner longtemps encore à peu près les mêmes rendements.
4° A la taille en Cordon de Royat
Les cas d’apoplexie ou de dépérissement ne s’y observent guère avant vingt à vingt-cinq ans.
Lorsque les rajeunissements des sous-bras qui portent les coursons ne sont pas faits dans de bonnes conditions, ces sous-bras dépérissent par dessèchement ou par apoplexie.
Les cas d’apoplexie du cep entier sont assez rares, car ils ne se produisent qu’à la suite du ravalement du cordon près de la soudure. Avec ce système de taille, la canalisation de la sève ne subit d’altération par la taille que sur les sous-bras, le tronc du cep restant entièernent sain de la soudure au premier fil de fer et portant seulement quelques plaies sur les bras à la base des sous-bras.
La taille en cordon de Royal, même avec le Saint-Emilion, est à peu près complètement abandonnée en Charente, les rendements qu’elle permet d’obtenir étant in rieurs à ceux produits par les tailles Guyot simple ou double.
5° A la taille usuelle des vignes en treille
Les vignes conduites en treille, le long d’un mur, sur un treillage ou sur un arbre, ont une vigueur et une production qui vont en augmentant avec l’âge, tout au moins jusque 20 ou 25 ans A partir de la trentième année – à l’âge où le nombre de non-valeurs et de manquants, dans nos vignes conduites aux tailles Guyot simple et double, impose l’arrachage des pieds subsistants – les treilles se maintiennent vigoureuses et fructifères et cela pendant longtemps.
Les cas de dépérissements sont rares et ceux d’apoplexie tout à fait exeptionnels.
Cependant, à la suite de ravalements trop tardifs ou mal exécutés des sous-bras portant les coursons, ces sous-bras peuvent être atteints d’apoplexie, mais ce n’est que tout à fait exceptionnellement que nous constaterons la disparition complète d’une treille par apoplexie générale.
Telles sont les observations que nous avons faites et que chacun peut faire aisément. Pour plus de clarté nous les résumons en un tableau récapitulatif.

Ainsi, de la comparaison des constatations résumées dans ce tableau, il résulte que les cas de dépérissement progressif et d’apoplexie sont beaucoup plus nombreux avec les systèmes de taille Guyot simple et double, tels qu’ils ont été pratiqués jusqu’à maintenant, qu’avec les autres systèmes de taille étudiés ci-dessus (gobelets à longs bras, cordons de Royat) et qu’ils sont moins nombreux dans les vignes taillées en treille qu’avec tout autre système.
D’ailleurs ces observations ne sont pas nouvelles: nous les avons trouvées élégamment formulées dans les mémoires présentés en 1887, 1888 et 1890 par un viticulteur éminent, M. Dezeimeris, où il résume ses observations pratiques et donne les raisons des différences qu’après lui nous avons constatées. Mais on ne prêta peut-être pas aux observations de M. Dezeimeris toute l’attention qu’elles méritaient parce que cet auteur crut trouver, dans l’application d’une taille modifiée, un remède efficace contre le phylloxéra, le grand ennemi du temps, et les vignerons qui avaient planté des jeunes vignes greffées, après la destruction des leurs, obtenant rapidement une belle rémunération, n’étaient pas encore soucieux de la longévité de leurs nouveaux vignobles.
Les observations de Dezeimeris , bien qu’elles n’aient porté que sur de jeunes vignes greffées, étaient si précises qu’il a pu expliquer, avant de l’avoir vu lui-même, comment périraient, au cours de la période la plus chaude de l’année, les vignes âgées, dont la circulation de la sève serait entravée par les mutilations de la taille et les conséquences de ces mutilations.
En comparant les différences de vigueur et de fructification de vignes françaises greffées soumises à la taille du Médoc à deux bras, et une vigne en treille, Dezeimeris s’exprime ainsi:
«Lorsque dans un rang de ceps de 5 à 6 ans, j’ai entrevu un cep moins beau que les autres, j’ai scruté de près sa structure, et j’ai constaté que des blessures sérieuses lui avaient porté dommage – c’étaient ou bien des sections presque horizontales qui avaient reçu les eaux de pluie, altéré la moelle, facilité les fendillements par la gelée ou par la chaleur, ou bien c’étaient des coupes étendues, provenant de l’ablation des astes, c’est-à-dire de bois de deux ans, coupes effectuées au sommet de la tige mère, quelquefois coïncidant des deux côtés et oblitérant par le volume de leur dessiccation interne une partie importante du calibre des tissus, destiné soit à l’emmagasinement des ressources vitales, soit à la circulation du courant général de la sève».
«A côté de ce fait, envisageons l’état d’une treille (à cordon unilatéral ou bilatéral) placée sur un treillage, le long d’un mur ou sur un arbre, en plein champ…
On la charge un peu plus chaque année, et chaque année, sans être exténuée, elle donne des masses énormes de raisins, et bien que la variété de vigne qui la constitue ne soit pas spécifiquement résistante, elle résiste au phylloxéra dans une mesure très grande. Quelle condicondition particulière peut donc produire ces résultats si dignes de remarque?»
«Cette condition est celle-ci; ce pied de vigne en treille n’a jamais aucune blessure à subir sur sa tige, il n’en a pas davantage à subir sur ses cordons, car la taille s’y opère sur des coursons émanant horizontalement du cordon, mais ne l’affectant point par leurs propres malaises, Le pied, tige et bras, grossit chaque année sans qu’aucun trouble direct vienne embarrasser le canal à sève toujours grossissant et toujours disposé à produire davantage.
Cette comparaison ne montre-t-elle pas avec une puissante évidence combien il y a de sérieuses raisons pour, éviter des mutilations annuelles directes sur la membrure maîtresse des ceps de nos vignobles? » (cas de la taille Guyot simple).
Tasuta katkend on lõppenud.